 Abstention: la solution? (page 2)
Abstention: la solution? (page 2)
Pour en finir avec l'élection présidentielle / Présidentielle : "Le véritable acte protestataire, c’est l’abstention" / Non l'abstention ne favorise pas le FN
La présidentielle de trop.
 ette élection est devenue un scrutin dangereux, qui ne sert plus qu'à produire de la frustration et à fournir un supplément d'âme symbolique à une fonction affaiblie.
ette élection est devenue un scrutin dangereux, qui ne sert plus qu'à produire de la frustration et à fournir un supplément d'âme symbolique à une fonction affaiblie.
Le 24 septembre 2000, deux mois après mes dix-huit ans, j'ai voté pour la première fois. Alors président de la République, Jacques Chirac proposait aux électeurs de raccourcir le mandat présidentiel de sept à cinq ans. Tenir à une fréquence plus régulière l'élection la plus importante pour l'avenir du pays: qui aurait pu dire non? 2,7 millions de personnes –je n'étais pas du nombre. Dix-sept ans plus tard, les choses ont changé: je me dis non seulement qu'élire plus souvent le président n'est pas la panacée, mais qu'il serait peut-être temps que nous, électeurs «de base», ne l'élisions plus tout court.
Cette idée encore marginale est de moins en moins silencieuse. En 2014, l'éditorialiste de France Inter Thomas Legrand déplorait, dans un livre au titre programmatique, Arrêtons d'élire des présidents!: «le mode de désignation du président [...] entraîne tant de faux débats, des clivages factices, de la bipolarité artificielle, de l'infantilisation populiste». Un an plus tard, la journaliste de Challenges Ghislaine Ottenheimer, dans Poison présidentiel, voyait dans cette exception française (nous sommes le seul pays d'Europe de l'ouest à élire au suffrage universel direct un président si puissant) une fierté imméritée: «Que la France ne soit pas tombée, comme les démocraties parlementaires, dans la médiocrité des combines et des coalitions procure une sorte de sentiment de supériorité.» Sentiment qui entrave le développement de notre démocratie:
«La IVe fut une calamité, un cauchemar. La Ve, elle, est un roc. Voilà le diktat des élites dans leur immense majorité. Et l'élection du chef en est la clef de voûte.»
Dans un essai publié en 2002, Stéphane Baumont, maître de conférences en droit public à l'université de Toulouse, assimilait lui la présidentielle à une «ambiance de guerre civile froide, [...] un affrontement, bloc contre bloc, ne correspondant à aucune réalité sociologique». Aujourd'hui, il explique que la meilleure solution serait de faire élire le chef de l'État par un collège d'élus assez large, et estime ironiquement que la suppression de la présidentielle au suffrage universel direct «fait partie des utopies ou hérésies de politiques ou d'universitaires, qui se heurtent à la fréquente affirmation selon laquelle supprimer cette élection serait supprimer la démocratie ou la République, au motif que c'est celle qui connaît le moins d'abstention».
Une machine à produire de la déception
Plus populaire, la présidentielle? Dans les bureaux de vote, certainement: en 2012, 80% des électeurs se sont déplacés au premier tour, et autant au second. Au total, 87% des Français inscrits se sont prononcés lors d'au moins un des deux tours. Mais avant que leur intérêt ne soit plombé, en 2002, par leur alignement systématique sur la présidentielle, les législatives faisaient aussi plutôt recette, avec une participation très rarement inférieure à 70% et qui, dans les bonnes années, concurrençait celle de la présidentielle –85% en 1978, quand Valéry Giscard d'Estaing appela au «bon choix» pour éviter la victoire d'une gauche désunie, et échappa à ce qu'on n'appelait pas encore la cohabitation.
Surtout, les enquêtes d'opinion menées depuis une décennie montrent que l'institution présidentielle en tant que telle ne fait pas l'objet d'une confiance plus grande –elle est même souvent un peu plus basse– que le Parlement, et est nettement moins populaire que les institutions locales. La présidentielle est une machine à produire de la participation, mais aussi de la déception. Une drogue à la descente très amère, et dont nous réclamons des doses toujours plus fortes (en médiatisation, en sondages, en rebondissements...). «À l'heure des réseaux sociaux, de la démocratie participative, de l'interactivité et de l'échange horizontal des volontés, cette mobilisation verticale est névrotique: elle suscite des troubles émotionnels dont les citoyens ne peuvent se défaire», écrit le professeur de droit Paul Alliès, proche d'Arnaud Montebourg, dans son récent livre Le Rêve d'autre chose. Changer la République ou changer de République.
L'évolution de la confiance des Français dans leurs institutions depuis décembre 2009 (Baromètre de la confiance politique réalisé par OpinionWay pour le Cevipof, janvier 2017)
La présidentielle est aussi supposée être un scrutin plus efficace et juste que les autres: c'est le seul, en France, où l'élu est assuré d'un score supérieur à 50% des suffrages exprimés. Ce n'est pas elle qui consacrerait un candidat avec une majorité relative, comme c'est régulièrement le cas aux législatives, aux régionales ou aux municipales. Qui amènerait aux responsabilités exécutives un dirigeant désigné sans avoir pris la tête de la campagne de son camp, comme ce fut le cas lors des dernières élections législatives de la IVe République, en 1956. Ou qui donnerait la victoire au camp minoritaire en voix, comme Donald Trump aux États-Unis en novembre dernier ou les travaillistes britanniques dans un passé plus lointain.
Et pourtant, c'est oublier les failles de ce mode de scrutin, que seuls des systèmes eux-mêmes complexes, comme le jugement majoritaire, pourraient permettre d'aider à combler. En 2002, la dispersion des voix à gauche a permis l'élimination de Lionel Jospin et la présence au second tour de Jean-Marie Le Pen, candidat seulement capable de passer d'un tour à l'autre de 17% des voix à... 18% (là où l'éliminé du premier tour était donné autour de 50%). En 2007, le troisième homme François Bayrou était plus populaire que les deux finalistes, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, avant le premier tour, et donné vainqueur en cas de duel face à la droite; juste après son élimination, sa cote de popularité monta davantage que celle des deux qualifiés...
«Je ne vote pour personne. Je vote seulement contre»
En réalité, la présidentielle française n'a vraiment été efficace que quand notre système de partis a été le plus «lisible», dans les années 1970 et au début des années 1980. C'était l'époque du «quadrille bipolaire»: deux camps bien identifiés, la gauche parlementaire et la droite parlementaire, recueillant en cumulé entre 45% et 50% des suffrages chacun, et comptant deux partis puissants, PCF et PS à gauche, gaullistes et droite non-gaulliste en face. Le célèbre dicton «Au premier tour on choisit, au second on élimine» fonctionnait à plein: en 1981, le premier tour a fait office de primaire entre les partis de chaque côté, et au second tour, les électeurs ont, pour la plupart, voté pour le survivant de leur camp. Depuis, le quadrille s'est désagrégé, avec l'émergence de cet objet politique mal identifié qu'est le FN et sa mise en orbite comme seul parti avec une base suffisante, en 2017, pour quasiment s'assurer une place au second tour; et avec l'affaiblissement du clivage gauche-droite et l'émergence de candidatures «ni gauche ni droite», type Bayrou en 2007 ou Macron en 2017.
Cette année, on ne choisit plus: on élimine tout le temps. «Un ami français m'a récemment dit: “Je ne vote pour personne. Je vote seulement contre”. Voilà le mantra dépressif de la politique française actuellement», écrivait la semaine dernière Robert Tombs, professeur à Cambridge, dans le magazine conservateur britannique The Spectator. À une époque, l'électeur de gauche était culpabilisé s'il ne votait pas PS dès le premier tour, soupçonné de braver le risque d'élimination de son camp. Cette année, il risque de l'être s'il ne vote pas Macron, soupçonné qu'il sera de tout miser sur un dangereux duel Hamon-Le Pen au risque de se retrouver avec un Fillon-Le Pen. (Et on n'écartera pas l'hypothèse que le même phénomène se produise à droite si les sondages montrent Fillon dévisser dangereusement au second tour contre la candidate frontiste).
Pour en finir avec l’élection présidentielle.
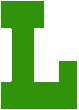 'élection du président de la République au suffrage universel est, dit-on, une avancée démocratique incontestable, en ce qu’elle permet au peuple de choisir directement un homme et une politique. Selon P. Brunet et A. Le Pillouer, au contraire, l’élection présidentielle au suffrage universel déséquilibre nos institutions et fragilise la vie politique.
'élection du président de la République au suffrage universel est, dit-on, une avancée démocratique incontestable, en ce qu’elle permet au peuple de choisir directement un homme et une politique. Selon P. Brunet et A. Le Pillouer, au contraire, l’élection présidentielle au suffrage universel déséquilibre nos institutions et fragilise la vie politique.
Pour la première fois depuis des décennies, les commentaires relatifs aux élections présidentielles à venir ne se contentent pas des traditionnelles estimations des chances respectives des candidats potentiels ou déclarés, mais mettent également en cause certains effets pervers de ce mode de désignation du chef de l’État. Selon les cas, on regrette que le système, tel qu’organisé aujourd’hui, puisse potentiellement produire un « 21 avril bis » (qu’il soit à l’envers ou à l’endroit, pour reprendre l’expression médiatiquement consacrée), ou bien on relève les conséquences désastreuses, pour la santé politique de notre pays, d’une telle compétition de « personnalités » à l’heure des mass media, des communicants professionnels et du papier glacé.
Il apparaît toutefois nécessaire d’aller plus loin que la seule dénonciation de ses effets pervers pour enfin remettre en cause, du point de vue de la théorie constitutionnelle, le principe même de l’élection du président au suffrage universel direct. Celle-ci est en effet à l’origine des dérives qui affectent la Ve République (personnalisation, perte d’autorité morale, conflits d’intérêt, défiance des citoyens à l’égard des institutions et du personnel politique etc.) qui toutes sont liées, de près ou de loin, à l’extrême concentration des pouvoirs dans les mains du président. En effet, si on a pu reprocher à la Révolution d’avoir substitué une Assemblée despotique à un monarque absolu ; si, plus tard, on fit grief à la Troisième République d’avoir remplacé l’Empereur par une Chambre qualifiée elle aussi d’absolue, la situation semble inversée : à l’omnipotence de l’assemblée de la Quatrième République s’est substituée celle du président de la Cinquième. Aussi le temps semble venu de se demander s’il ne serait pas opportun d’en supprimer la cause essentielle : son élection au suffrage universel direct.
Intouchable élection présidentielle ?
L’idée surprendra peut-être, puisque le débat, sur le sujet, n’existe tout simplement pas – ni dans les milieux politiques, ni dans la sphère médiatique, ni même dans le monde académique. On est d’ailleurs tenté de balayer la question d’un revers de la main, au motif que la suppression de cette élection est de ces réformes qui « ne se feront tout simplement pas ». Mais ce serait prendre une prophétie auto-réalisatrice pour un argument, tout comme l’enfant croit pouvoir se soustraire à une sollicitation quelconque en se bornant à dire qu’il « n’y arrivera pas ». L’autre effet d’une telle prédiction est qu’en coupant court à toute réflexion, elle interdit d’envisager les éventuels inconvénients de cette élection et, en retour, les avantages de sa suppression.
Qu’on se rassure, soulever la question ne revient pas pour nous à demander ni même à espérer la suspension du processus électoral à venir : les élections prévues en 2012 auront évidemment bel et bien lieu. On peut, en revanche, fortement douter que par la suite, la pratique institutionnelle suivra son cours comme s’il ne s’était rien passé jusque-là, alors que le quinquennat qui s’achève aura été marqué par l’avènement de ce que l’on a appelé l’« hyperprésidence » ou encore l’« omniprésidence ». Chacun conviendra que la personnalité du président y aura été pour beaucoup. En réalité, l’hyperprésidence est sécrétée par les institutions de la Cinquième République telles qu’elles ont évolué jusqu’à aujourd’hui.
Nous devons cependant reconnaître que la réforme du mode de désignation du président de la République n’a, en l’état actuel des choses, que peu de chances d’aboutir à court terme – non pas du fait de la popularité que les principaux partis politiques prêteraient à l’élection présidentielle, mais parce que cette réforme ne saurait en tout état de cause être réalisée que par le vainqueur d’une telle élection. Cela est sans doute à peu près aussi vraisemblable que de voir le Sénat accepter une révision de la Constitution qui reverrait à la baisse ses propres compétences [1]. Nous refusons cependant de succomber au fatalisme sur une telle question : l’histoire regorge d’accidents de parcours et rien ne dit que la nécessité d’une telle réforme ne se fasse sentir un jour prochain. Ce jour-là, il faudra que les motifs, selon nous puissants, qui justifient que l’on revienne sur l’élection du président au suffrage universel direct soient connus : c’est pour cela que le débat doit, d’ores et déjà, avoir lieu.
Ce mode de désignation du chef de l’État semble pourtant posséder toutes les vertus : on avance en général que cette élection est populaire et qu’il serait donc malvenu de la remettre en cause, à une époque si méfiante à l’égard de la politique. On ajoute parfois qu’elle serait moderne, efficace et démocratique. C’est encore à voir…
Populaire ?
Populaire, cette élection l’est peut-être, mais en quel sens du terme exactement ? Il y a là une profonde ambiguïté qui, il faut bien le reconnaître, contribue sans nul doute à l’efficacité de l’argument [2] car, derrière l’évidence de l’adjectif, se dissimulent essentiellement deux thèses très contestables qui n’en produisent pas moins, lorsqu’elles sont ainsi mêlées, un effet rhétorique redoutable. La première thèse est peut-être la plus répandue : elle consiste à soutenir qu’à l’heure où les Français se détournent de la politique, il serait assez paradoxal de supprimer la seule élection où des taux de participation élevés continuent d’être observés. C’est faire un usage singulier du concept de « popularité » puisque l’on réduit cette dernière au succès (pratique) que cette élection rencontre sans se soucier de l’adhésion (théorique) qu’elle suscite. Or, rien ne dit que les deux sont nécessairement liés. Là n’est toutefois pas l’essentiel. Bien évidemment, les Français se passionnent pour les campagnes présidentielles et l’abstention y est donc bien plus faible que pour les autres scrutins. Mais c’est là que réside précisément le problème : à prendre comme seul indice de sa popularité le taux de participation à cette élection, on néglige le taux de déception qu’elle engendre, tant la personnalisation et la dramaturgie excessives à laquelle cette élection conduit inéluctablement, nourrissent le mythe de l’homme providentiel. Or, d’une part, la désillusion est toujours à la hauteur du fol espoir que l’on a bien été contraint de créer pour s’extirper des désillusions précédentes. D’autre part, en focalisant toute l’attention du public, cette compétition occulte l’importance (pourtant réelle) des autres scrutins. Aussi l’élection du président au suffrage universel direct est-elle nocive pour la santé politique de notre pays en ce qu’elle laisse place à l’idée que la démocratie pourrait se réduire à la volonté d’un seul homme. Il ne faut dès lors pas s’étonner que l’abstention augmente pour tous les autres scrutins lesquels, médiatiquement moins spectaculaires, apparaissent politiquement moins décisifs. Populaire, l’élection du président ne l’est donc qu’en surface : au fond, elle mine insidieusement la confiance de nos concitoyens dans leurs institutions.
La seconde thèse consiste à employer « populaire » au sens le plus commun du terme pour dire que les Français seraient « très attachés » à l’élection du président au suffrage universel direct, que cette dernière symboliserait leur capacité à agir démocratiquement et qu’il serait malvenu, sinon inconvenant, en tous les cas impossible, de proposer sa suppression. Une telle idée est foncièrement paradoxale : dans une société qui se veut démocratique en effet, la seule façon (légitime) d’établir cet « attachement » est encore de faire appel au corps électoral pour qu’il se prononce. L’inconvenant, c’est donc bien d’invoquer la popularité d’une institution pour refuser que soit engagé tout débat sur son maintien. Il ne serait pas sérieux à cet égard d’objecter que le peuple s’est déjà prononcé sur la question en 1962 car cela reviendrait à dire que ce qui a été fait un jour l’a été pour toujours. Mieux encore : ce serait (mais sans doute est-ce là le but) dissimuler combien la fonction de cette élection a profondément changé depuis 1962, notamment depuis que l’on a aligné la durée du mandat présidentiel sur celui des députés. Or, nul ne peut préjuger que le peuple a voulu ce que cette élection est devenue : comme tout législateur, ce que le peuple a fait, il peut le cas échéant le défaire. Compte tenu de ces évolutions, nous prétendons qu’interroger la pertinence de la désignation du président au suffrage universel direct s’avère aujourd’hui nécessaire : dans la sphère publique, d’abord, et le cas échéant, un jour, dans les urnes. Ce serait alors l’occasion de mesurer la popularité réelle de celle-ci. À défaut d’une telle consultation, on en est réduit soit à en postuler l’existence sur la base d’une expérience personnelle plus ou moins limitée (mais toujours généralisée à l’excès sur la base de vagues préjugés), soit à se fier à des « enquêtes d’opinion » qui n’en ont que le nom, puisqu’elles se bornent à demander leur opinion à des Français sans qu’ils aient jamais pu s’en forger une (puisque, par hypothèse, la question n’est pas posée publiquement).
Moderne ?
La supposée modernité de ce mode de désignation repose quant à elle sur l’idée (avancée plus souvent qu’à son tour lors de la réforme du quinquennat) que la plupart des systèmes démocratiques contemporains seraient organisés selon un schéma très similaire, consistant à permettre au corps électoral de désigner, à intervalles réguliers, un leader disposant à la fois de la liberté et du temps nécessaires à la mise en œuvre de la politique pour laquelle il a été élu. Tel serait le cas aux États-Unis, bien sûr, mais aussi dans les systèmes parlementaires, dans lesquels les élections législatives sont devenues une compétition personnelle entre les candidats au poste de Premier Ministre – et qui à certains égards finissent en effet par ressembler à nos élections présidentielles.
Pour qui examine cependant d’un peu plus près ces grandes démocraties, de telles similitudes sont infimes au regard de ce qui les sépare de notre système : ni les régimes parlementaires (où le premier ministre tire toute sa légitimité et donc son pouvoir de la majorité qui le soutient au Parlement), ni le régime américain (où le président doit en permanence composer avec un Congrès élu séparément, et tantôt insoumis, tantôt hostile), ni même les régimes dans lesquels le président est élu au suffrage universel direct (Autriche, Finlande, Portugal, etc. [3]), ne prétendent concentrer, comme en France, toute la légitimité démocratique sur un homme (ou une femme, qui sait ?) – supposé(e) en tirer l’autorité suffisante pour agir (presque) seul(e). Notre système n’a donc que les apparences de la modernité – si toutefois cela peut être considéré comme une vertu : il est le seul parmi les grandes démocraties contemporaines à organiser l’intronisation d’un individu par le suffrage universel afin de lui conférer le maximum de pouvoir. Tout ce qui persistait du régime de 1958 tendant à infléchir cette logique de concentration de la légitimité a été consciencieusement écarté – notamment, encore une fois, dans le sillage de la réforme du quinquennat (même si les germes de cette évolution étaient présents dès l’origine et qu’ils avaient commencé à prospérer bien longtemps avant la révision d’octobre 2000). En tout état de cause, si c’est cela, la « modernité » d’un système – élire un guide à suivre en toute circonstance – alors nous plaiderions volontiers pour un peu d’archaïsme dans nos institutions…
Efficace ?
Efficace, ce mode d’élection l’est sûrement – mais au regard de quelle fin ? S’il s’agit d’organiser la soumission du Parlement au président (ce dernier pouvant rappeler sans cesse aux députés qu’ils ne sont chacun que les élus d’une petite circonscription tandis qu’il l’est, lui, de la France entière), il y a là une forme d’efficacité dont il nous faudrait sans aucun doute faire l’économie, pour que notre démocratie retrouve quelques couleurs – nous y reviendrons. Mais peut-être veut-on seulement dire que l’élection du président au suffrage universel direct conduit à la bipolarisation de la vie politique, qui elle-même permet de stabiliser le gouvernement ? En ce cas, la thèse est plus que discutable : le regroupement des forces politiques en deux camps antagonistes résulte en fait du mode de scrutin majoritaire à deux tours qui se trouve être celui utilisé depuis des lustres pour les élections législatives. Aussi est-il tout à fait certain que cette bipolarisation se construit désormais surtout lors de ces dernières car il est vital pour toute formation politique désireuse d’obtenir quelques sièges au Parlement de nouer des alliances avec les partis plus importants. Dira-t-on que l’élection présidentielle, désormais couplée aux législatives, a le mérite de provoquer un effet d’entraînement et d’assurer au président une majorité confortable ? C’est déjà raisonner comme si cette élection était nécessaire sans avoir pris la peine de démontrer qu’une majorité stable n’était pas possible indépendamment d’elle. Rien ne prouve donc que revenir à un autre mode de désignation nous conduirait tout droit à un multipartisme échevelé et invoquer ce risque c’est agiter un spectre pour mieux légitimer l’immobilisme. Mais, plus fondamentalement, il faudrait s’interroger aussi sur les avantages comparatifs réels que procure de nos jours une telle bipolarisation : la seule volonté de stabiliser le gouvernement – la grande affaire des débuts de la Ve République – justifie-t-elle encore que tout (la diversité de l’offre politique, la qualité du débat public, la culture du compromis) lui soit sacrifié ?
Démocratique ?
Présidentielle : "Le véritable acte protestataire, c’est l’abstention"
 ’abstenir d’aller aux urnes, un danger pour la démocratie ? Au mieux, un geste inutile ? "Faux", répond Antoine Bueno, dans son dernier ouvrage "No Vote" (Editions Autrement), préfacé par Michel Onfray. Autrefois chargé de mission au Sénat et plume de François Bayrou, passé par le one-man-show, l'écrivain publie un manifeste pour une abstention "utile", qui plaide (sans rire) pour une réforme complète d’un système de représentation en crise, et ambitionne même d’enrayer la montée du FN en décomplexant les abstentionnistes. Entretien.
’abstenir d’aller aux urnes, un danger pour la démocratie ? Au mieux, un geste inutile ? "Faux", répond Antoine Bueno, dans son dernier ouvrage "No Vote" (Editions Autrement), préfacé par Michel Onfray. Autrefois chargé de mission au Sénat et plume de François Bayrou, passé par le one-man-show, l'écrivain publie un manifeste pour une abstention "utile", qui plaide (sans rire) pour une réforme complète d’un système de représentation en crise, et ambitionne même d’enrayer la montée du FN en décomplexant les abstentionnistes. Entretien.
Pourquoi n'irez-vous pas voter en mai ?
A quoi sert le vote aujourd’hui ? On s’achète une bonne conscience citoyenne en votant pour quelqu’un qui ne nous convainc pas, juste par principe et sans se poser trop de questions. C’est une citoyenneté au rabais. Notre système représentatif est fondamentalement conservateur : les élus des assemblées n’ont pas de pouvoir, les structures même de notre gouvernance conduisent à l’immobilisme. Personne ne veut mettre en œuvre des mesures impopulaires, ou qui bénéficient au plus grand nombre, mais entrent en contradiction avec les intérêts de corps minoritaires constitués - lobbys, syndicats, fonctionnaires...
L’acte de vote est une légitimation de ce système, donc, à moins qu’un candidat ne fasse des propositions de réforme institutionnelle profonde, je n’irai pas voter en mai. Peut-on dresser un profil de l’abstentionniste ?
Sociologiquement, on relève deux catégories d’abstentionnistes. D’abord les citoyens "sous-politisés", les plus nombreux, qui sont très éloignés des questions politiques. Ils considèrent que ça ne les regarde pas et donc ne se déplaceront pas pour voter. Ensuite, les abstentionnistes, dits actifs, "sur-politisés", à l’inverse. Pour eux, comme moi, l’abstention procède d’un choix politique.
Pourquoi ne pas voter blanc ?
En pratique, le vote blanc s’inscrit dans un cadre législatif qui est une double arnaque pour celui qui veut avoir un geste contestataire dans les urnes. Actuellement, le vote blanc ne fait pas parti des suffrages exprimés. Mais en votant blanc, on augmente le taux de participation, donc la légitimité des élus, soit le contraire de ce que l’on recherchait à priori.
L’abstention n’est-elle pas, par définition, improductive ?
Autant le vote est à coup sûr stérile, sans réformes institutionnelles de fond, autant l’abstention peut être réformatrice. Je préconise une abstention active. Je l’envisage comme un moyen de pression constructif, pour avancer dans sa citoyenneté et la reprendre en main.
Non, l’abstention ne favorise pas le Front national
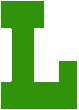 ’abstention ferait le lit du Front national. Cette antienne médiatique et de certains politiciens ne tient pas l’analyse, selon l’auteur de cette tribune. Qui assure que les partis dits « de gouvernement » sont les premiers responsables des « déterminants » du vote frontiste.
’abstention ferait le lit du Front national. Cette antienne médiatique et de certains politiciens ne tient pas l’analyse, selon l’auteur de cette tribune. Qui assure que les partis dits « de gouvernement » sont les premiers responsables des « déterminants » du vote frontiste.
Antoine Peillon est journaliste. Il est l’auteur, entre autres, de Ces 600 milliards qui manquent à la France : enquête au cœur de l’évasion fiscale (Le Seuil, 2012), de Corruption (Le Seuil, 2014) et de Résistance ! (Le Seuil, 2016). Son nouveau livre, Voter, c’est abdiquer ! Ranimons la démocratie !, est publié aux éditions Don Quichotte.
« Quand l’abstention fait le lit de l’extrême droite », titrait Le Nouvel Observateur, en juin 2002, avant le premier tour des élections législatives, lequel enregistra pourtant une hausse significative du taux d’abstention (de 32 % en 1997 à 35,60 % en 2002), mais une baisse tout aussi nette du FN (de 14,94 % des exprimés en 1997 à 11,34 % en 2002)… Une douzaine d’années plus tard, l’émission « Façon de penser », du Mouv’ (station de Radio France « à destination des publics jeunes »), du 26 mars 2014, continuait d’affirmer, entre les deux tours des dernières élections municipales, et sans la moindre argumentation : « On serait tenté de dire que l’abstention est une attitude irresponsable qui met en danger la démocratie : d’abord, parce qu’elle fait le lit du Front national… »
Ce délire médiatique, totalement contradictoire avec la réalité du phénomène dénoncé, s’articule malheureusement à la désinformation de certains politiciens patentés. Ainsi, Frédéric Barbier (PS) étant vainqueur d’une élection législative partielle dans le Doubs, le dimanche 8 févier 2015, son concurrent UMP vaincu, Édouard Philippe, déclarait le lendemain matin, au micro de Jean-Jacques Bourdin (RMC – BFMTV), sans sourciller : « Systématiquement, quand les participations sont faibles, les scores du Front national sont plus élevés. C’est une mécanique dont il faut avoir conscience. » De même, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste, assénait le 15 mars 2015, sur France 5, à la veille des élections départementales des 22 et 29 mars : « Le problème, c’est que le Front national a quasiment tout le temps le même nombre de voix. Mais l’abstention est là. Si vous avez de l’abstention, le Front national est beaucoup plus haut. » Pourtant, cinq jours plus tôt, Marion Maréchal-Le Pen, députée FN du Vaucluse, soutenait exactement le contraire sur les ondes de France Info : « J’invite à lutter contre l’abstention, parce que l’expérience des campagnes prouve que plus la participation est forte, plus le Front national est fort. » Comprenne qui pourra…
« Les dirigeants du FN disent d’ailleurs eux-mêmes que l’abstention est leur principal adversaire »



