 Sarkozy et son ami Bachar al-Assad
Sarkozy et son ami Bachar al-Assad
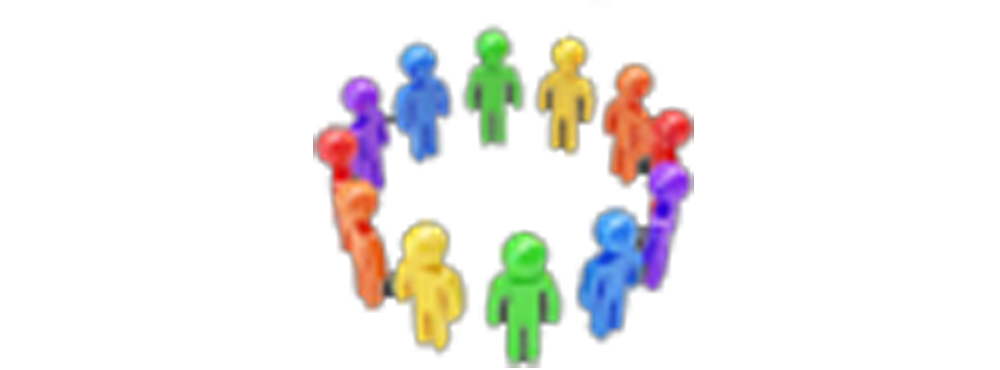
Surtout ne pas avoir la mémoire courte. Ne pas se laisser berner par les positions et déclarations actuelles du président. Ne jamais oublier qu'hier encore il entretenait avec les dictateurs les plus sanglants de la planète des relations suivies.
Sarkozy et son ami Bachar al-Assad
Alors que la répression continue en Syrie et que le régime refuse d'appliquer l'accord qu'il a signé avec la Ligue Arabe, voici l'enquête que Christophe Boltanski et moi avons publiée la semaine dernière dans le "Nouvel Observateur" à propos des relations entre Nicolas Sarkozy et Bachar al-Assad.
Son ami Bachar
L'ambiance est tendue, ce 15 juin 2008, quand les émissaires de Nicolas Sarkozy entrent dans le bureau de Bachar al-Assad à Damas. Un mois plus tard, le dictateur, si longtemps persona non grata à Paris, doit assister au défilé du 14-Juillet. Sa présence provoque déjà la polémique. Afin d'adoucir les critiques, les Français ont mission de lui arracher un geste : la libération d'une poignée de prisonniers politiques malades. Comment lui, que plus personne ne reçoit, pourrait-il regimber ? Pourtant, d'un revers de main, le raïs refuse. « Ce fut un non net et brutal », confie l'un des émissaires élyséens, Boris Boillon, à un diplomate américain. Ce dernier interroge alors le Français : après une telle rebuffade, le président Sarkozy va-t-il annuler l'invitation ? Finalement, non.Boillon, gêné : « Nous ne ferons pas de la question des droits de l'homme une condition. »
Cette conversation révélée par Wikileaks en apporte une preuve accablante : avec les tyrans arabes, Nicolas Sarkozy s'est renié, abandonnant sans combattre les grands principes brandis pendant la campagne électorale. A sa décharge, avec Moubarak, Ben Ali et Kadhafi, il n'a pas été le seul chef d'Etat occidental à se compromettre. Mais le cas de Bachar al-Assad est différent. C'est le président français - et lui seul - qui a organisé le retour en grâce du Syrien, chef de l'un des pires régimes de la planète, dans la communauté internationale. Depuis, pendant plus de trois ans, contre l'avis d'une grande partie du Quai d'Orsay, il a couvé l'homme de Damas comme personne, le recevant à plusieurs reprises avec tous les honneurs. En dépit des condamnations d'opposants, des tortures dans les prisons, des massacres.
Aujourd'hui Nicolas Sarkozy - dont Assad était encore l'hôte en décembre dernier - n'a pas de mots assez durs pour condamner la répression sanglante en Syrie. Après avoir été le premier à réhabiliter son régime criminel, le président est devenu l'un de ses plus grands pourfendeurs. Comme si cette fermeté affichée servait à masquer ses compromissions et ses naïvetés passées. Comme s'il voulait faire oublier à quel point, pendant trois ans, son ami Bachar l'avait roulé.
Il croyait pourtant dur comme fer avoir tout compris de la Syrie. En 1997, redevenu simple député pour cause d'alternance, il reçoit une invitation du parti Baas, au pouvoir depuis un demi-siècle. Trois jours d'entretiens avec des apparatchiks, notamment Farouk al-Chareh, alors ministre des Affaires étrangères. Cinq jours de tourisme avec Cécilia aux frais de ses hôtes. A l'issue de son périple, il se croit autorisé à écrire dans son livre « Libre » : « Après trois ans, [l'ambassadeur de France, ndlr] n'en connaissait pas beaucoup plus que nous en huit jours. » Sarkozy repart de l'Orient compliqué avec des idées très simples sur la « tolérance religieuse » et la « fierté syrienne ». « Il est revenu avec le syndrome de Lawrence d'Arabie », plaisante l'un de ses anciens collaborateurs.
Quand il redevient ministre de l'Intérieur, en 2005, la France est en guerre diplomatique avec Damas, après l'assassinat attribué aux services syriens de l'ami du président Jacques Chirac, l'ex-Premier ministre libanais Rafic Hariri. La Syrie se retrouve au ban de la communauté internationale, à coups de sanctions et d'embargos. L'Elysée veut faire mal au régime d'Al-Assad. Mais sans dépasser certaines limites. La France entend maintenir à tout prix au moins un lien : les échanges entre services dans la lutte antiterroriste. La DST vient alors d'installer dans la plus grande discrétion son bureau régional à Damas. « Les Syriens nous ont menacés de suspendre la collaboration sécuritaire si nous les mettions à genoux, raconte un bon connaisseur du dossier. Or ils arrêtaient des présumés jihadistes français en route vers l'Irak et nous les renvoyaient après les avoir interrogés à leur manière... On en a récupéré des dizaines comme ça. Il fallait que ça continue. » A l'Intérieur, Nicolas Sarkozy poursuit cette coopération sulfureuse sans état d'âme. Son directeur de cabinet, Claude Guéant, reçoit le tortionnaire en chef du régime, soupçonné d'être l'organisateur du meurtre de Hariri, tout-puissant patron des renseignements militaires, Asef Chaoukat. Une relation particulière s'installe.
Les al-Assad déjeunent à L'Elysée en décembre dernier....
C'est donc tout naturellement en Syrie que, devenu président, Sarkozy veut marquer sa rupture la plus brutale avec l'ère Chirac. Depuis la mort de Hariri, le vieux président est devenu l'ennemi juré de Bachar al-Assad. Cette haine - et la politique d'isolement qui va avec -, Jacques Chirac entend la transmettre à son successeur. En mai 2007, durant la passation de pouvoir, il organise une rencontre entre Nicolas Sarkozy et le fils de son ami assassiné, Saad Hariri. Le nouvel élu se prête à l'exercice mais, au même moment, charge Claude Guéant de reprendre langue en catimini avec le régime syrien. L'espion Chaoukat étant en disgrâce, le secrétaire général de l'Elysée recourt aux services d'un personnage tout aussi controversé, aujourd'hui mis en examen dans l'enquête sur l'attentat de Karachi, l'homme d'affaires libanais Ziad Takieddine. « C'est lui qui nous a fait passer le message que la Syrie aimerait reprendre contact avec nous », racontera-t-il plus tard à « Libération ».
De cette volte-face, Nicolas Sarkozy espère tirer des gains mirobolants. Un soutien crucial à son projet phare Union pour la Méditerranée, un rôle dans le processus dit de paix avec Israël, un éloigne ment de la Syrie du parrain iranien, la reconnaissance de l'indépendance du Liban et, aussi, bien sûr, quelques gros contrats. En échange, il va accueillir Bachar à bras ouverts. Mieux, le réintroduire dans le concert des nations. Pour le Syrien, c'est inespéré. Quand la France déroule le tapis rouge devant Kadhafi, en décembre 2007, elle reçoit un homme déjà courtisé par la Terre entière. Assad en revanche est toujours un paria. Pis. Il poursuit en secret un programme nucléaire militaire, à la différence de l'Ubu de Tripoli, qui a renoncé à la bombe. Circonstance aggravante, la France, si sourcilleuse sur ce point à l'égard de l'Iran, ferme les yeux en toute connaissance de cause. « Dès le début, nous connaissions l'existence de la centrale atomique d'Al-Khibar, avant même qu'elle ne soit, en septembre 2007, bombardée par les Israéliens. La preuve Nous avons même donné des photos à l'Agence internationale à l'Energie atomique », confie un haut responsable français. « Malgré tout, ce n'était pas forcément idiot de sortir de la guéguerre de Chirac, qui ne conduisait nulle part. Mais on est allé trop vite, trop loin. On s'est fait avoir », souligne l'un des acteurs de ce rapprochement. «Nous étions très fermes, se défend-on à l'Elysée. Nous savions que la tentation permanente de Bachar, c'était d'empocher et de donner le moins possible. La règle était : pas de résultat, pas de dialogue. »
Voire... Fin décembre 2007, les Syriens bloquent toujours l'élection d'un président libanais. Ils veulent imposer un homme à eux. Les Français sont furieux. Nicolas Sarkozy annonce haut et fort l'arrêt des pourparlers avec Damas. Mais sa colère ne dure pas. Quelques semaines après, mezza voce, « le conseiller diplomatique du président, Jean-David Lévitte, relance ses interlocuteurs syriens », rapporte un familier du dossier. A l'approche du sommet de l'Union pour la Méditerranée, prévu six mois plus tard, la panique s'est emparée de l'Elysée. Il faut absolument que Damas soutienne le projet présidentiel qui bat de l'aile. Car sans la Syrie, pas d'Algérie, donc pas de Maghreb et pas de grand-messe. Pour convaincre Bachar al-Assad de plaider son projet auprès des Algériens, les Français vont se renier : ils donnent leur bénédiction au candidat de Damas à la présidence libanaise, Michel Sleimane, qui sera finalement élu en mai 2008.
L'Elysée arrache tout de même une concession importante, même si certains affirmeront qu'elle était acquise depuis longtemps. Pour la première fois, les Syriens acceptent de dépêcher un ambassadeur au Liban, qu'ils considéraient jusque-là comme une de leurs provinces. Bachar al-Assad l'annonce solennellement au cours d'une conférence de presse à Paris, le 12 juillet 2008. Deux jours plus tard, il prend place à la tribune officielle place de la Concorde. « Il nous a dit avoir assisté à un !4-Juillet quand il était étudiant, parmi la foule,raconte-t-on dans l'entourage de Sarkozy. Il était très heureux d'être là. » Les militaires, eux, sont meurtris de défiler devant le chef d'un régime responsable de la mort de tant des leurs lors de l'attentat du Drakkar, à Beyrouth, en 1983.
Les autorités françaises ne se contentent pas d'offrir un podium au dictateur syrien, elles font aussi en sous-main sa promotion. A la veille du sommet, Claude Guéant organise, via Takieddine, une interview de Bachar al-Assad par le directeur du « Figaro », Etienne Mougeotte. Un modèle du genre. Pas une question sur les droits de l'homme. Paris s'efforce de « vendre » le dictateur comme un homme moderne - n'a-t-il pas étudié l'ophtalmologie à Londres ? -, francophile et vaguement francophone. Plus encore son épouse, Asma, passée par la banque JP Morgan, décrite comme une « Diana orientale » par « Paris Match ». « Les orientations réformatrices de Bachar étaient un vrai encouragement », plaide-t-on aujourd'hui à l'Elysée. « Quand on lui expliquait que c'était un tyran de la pire espèce, Sarkozy répondait : «Bachar protège les chrétiens et avec une femme aussi moderne que la sienne, il ne peut pas être complètement mauvais» », raconte Bernard Kouchner, alors son ministre des Affaires étrangères.
Et pourtant ... Juste avant le 14-Juillet, une révolte de détenus politiques à la prison de Sadneya est réprimée dans le sang. Entre 20 et 40 morts. Pas un mot de Paris. Quinze jours après les fastes de la Concorde, 12 des principaux opposants du régime, y compris les personnalités dont le jeune Boillon réclamait la libération, sont lourdement condamnés par un tribunal militaire. Un camouflet qui n'empêche pas Nicolas Sarkozy de se rendre en Syrie au mois de septembre. Cette visite d'Etat est le début de la lune de miel. Les Syriens font miroiter des contrats colossaux. Un projet de métro promis à Alstom, une ligne de chemin de fer entre Alep et la capitale, la rénovation de l'aéroport de Damas, deux gisements pétrolifères pour Total, la vente record de 54 Airbus à Syrian Air. Presque tous les ministres français vont emboîter le pas au président : Fillon, Mitterrand, Lagarde, Bussereau, Idrac... même la secrétaire d'Etat chargée de la politique de la ville, Fadela Amara. Jusqu'au patron du Louvre, Henri Loyrette, qui rend plusieurs fois visite à la belle Asma al-Assad pour mettre au point un accord avec le musée national de Damas, alors que son dictateur de mari nous fera l'honneur chaque année de sa visite à Paris. La dernière a lieu à la veille du printemps arabe, en décembre 2010. Le clou de cette ultime rencontre : un déjeuner très médiatisé entre les deux premières dames, Carla et Asma.
A Damas, l'ambassadeur français, Eric Chevallier, ancien porte-parole de Bernard Kouchner, applique cette politique de rapprochement avec un zèle qui suscite l'embarras au Quai-d'Orsay. A peine arrivé, à l'été 2009, il reçoit à la résidence de France celui que ses prédécesseurs ont toujours tenu à distance : le cousin de Bachar, Rami Makhlouf, qui gère les biens de la famille et symbolise, plus que tout autre, la corruption du régime. Tandis que les opposants croupissent dans les prisons, le représentant de la France noue des relations avec certaines des figures les plus détestées du pouvoir. Notamment le fils de l'ancien ministre de la Défense, Mustafa Tlas, un autre dignitaire reconverti dans les « affaires », qu'il convie à la cérémonie du 14-Juillet 2010.
Tout ça pour quoi ? Les contrats ? Hormis une cimenterie bâtie par Lafarge, ils ont fait « pschitt ». A commencer par le plus prometteur : Airbus. Washington, qui n'a jamais levé son embargo sur les technologies sensibles à destination de la Syrie, oppose son veto à la vente des avions au motif qu'ils contiennent des pièces américaines. Une humiliation pour Sarkozy l'atlantiste. Les Etats-Unis interdisent même à Dassault de changer les roues du Falcone de Bachar !
Le rêve de Nicolas Sarkozy de damer le pion à l'Amérique dans la région tourne court. Israéliens et Syriens ont accepté de recevoir son médiateur, l'ancien patron de la DGSE et grand arabisant, Jean-Claude Cousseran. Ce dernier fait la navette entre Damas et Jérusalem à trois reprises au cours de l'année 2010 afin de relancer les pourparlers. Mais le soulèvement en Syrie mettra fin à une tentative dont on ignore si elle avait une chance d'aboutir. L'absence de processus de paix a raison également de l'Union pour la Méditerranée.
Reste le Liban. C'est le seul dossier sur lequel l'Elysée revendique toujours quelques succès. « Les assassinats de parlementaires ont cessé, des élections législatives ont pu se tenir, les institutions libanaises se sont remises à fonctionner, énumère une source à la présidence. Au total, le rapprochement franco-syrien a produit le résultat que Nicolas Sarkozy attendait. » Le président français va pourtant découvrir sur le tard l'étendue de la duplicité de Damas. Le premier à l'avertir est le roi Abdallah d'Arabie Saoudite, lors d'une rencontre à New York le 10 janvier 2011. « Ce Bachar est réellement impossible, dit-il. J'arrête les frais. » Le souverain, qui avait lui aussi renoué avec Damas, vient de comprendre que le Syrien est en train de le trahir au Liban. Le couperet tombe le 25 janvier. Un « coup d'Etat parlementaire », orchestré par la Syrie, provoque la chute du Premier ministre, Saad Hariri, le protégé des Saoudiens et celui de la France.
Gouvernement, présidence, armée, parlement... « Trois ans après notre intercession, la Syrie a récupéré toutes les cartes qu'elle avait perdues au Liban, souligne un ancien diplomate. Certes, elle n'occupe plus le pays, mais le Hezbollah s'en charge à sa place. » Et Bernard Kouchner de surenchérir : « De toutes les promesses faites par les Syriens, il ne subsiste que leur ambassade à Beyrouth, une maison fraîchement repeinte et toujours vide. »
Manifestation en Syrie en mai 2011
Le 10 octobre, le rideau se lève sur le Théâtre de l'Odéon. Le directeur, Olivier Py, a invité ce soir-là tout ce que Paris compte d'opposants au régime baassiste : l'éditeur Farouk Mardam Bey, les romanciers Samar Yazbek et Elias Khoury, la comédienne Darina al-Joundi et le tout nouveau porte-parole du Conseil national syrien, Burhan Ghalioun. Sur la scène, on lit des lettres de martyrs, on déploie le drapeau national. Assis au premier rang, un conseiller de l'Elysée et surtout, le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé. A la demande générale, le chef de la diplomatie prend la parole : « La France, avec les moyens qui sont les siens, sera au côté du peuple syrien dans son combat pour la liberté », proclame-t-il sous les applaudissements.
Que de chemin parcouru ! C'est le 26 avril, un mois après le début de la révolte et quelques jours après Barack Obama, que Nicolas Sarkozy qualifie la répression d'« inacceptable ». La lune de miel est bien finie. La France répète depuis que Bachar a perdu toute « légitimité ».
Trois mille morts plus tard, elle oeuvre à l'ONU pour l'adoption de sanctions et n'écarte pas une reconnaissance par Paris du Conseil national syrien. Dans la salle de l'Odéon, la joie a un goût amer. Farouk Mardam Bey n'a pas oublié le « triomphe » de Bachar le 14-Juillet à Paris. « Ce nouveau retournement de la France est réjouissant, reconnaît-il. Mais, dans le même temps, il donne le tournis. »
Christophe Boltanski et Vincent Jauvert
Article paru dans le "Nouvel Observateur" du 27 octobre 2011.




