 “Nous ne devons rien, nous ne paierons rien” — Tout ce qu’on vous a raconté sur la dette est faux
“Nous ne devons rien, nous ne paierons rien” — Tout ce qu’on vous a raconté sur la dette est faux
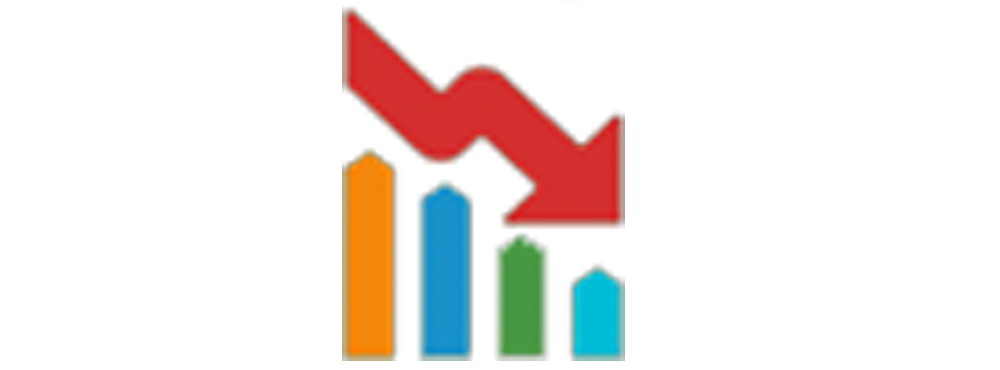
par Charles Eisenstein, originellement publié (en anglais) sur Yes! Magazine
 a légitimité d’un ordre social repose sur la légitimité de ses dettes. C’était également le cas dans le passé. Dans les cultures traditionnelles, la dette, au sens large — les dons réciproques, les souvenirs de services rendus, les obligations pas encore acquittées — était la glu qui assurait la cohésion de la société. Tout le monde, à un moment ou à un autre, a été débiteur de quelque chose envers quelqu’un. S’acquitter de ses dettes était indissociable de s’acquitter de ses obligations sociales ; Cela faisait écho aux principes d’équité et de gratitude.
a légitimité d’un ordre social repose sur la légitimité de ses dettes. C’était également le cas dans le passé. Dans les cultures traditionnelles, la dette, au sens large — les dons réciproques, les souvenirs de services rendus, les obligations pas encore acquittées — était la glu qui assurait la cohésion de la société. Tout le monde, à un moment ou à un autre, a été débiteur de quelque chose envers quelqu’un. S’acquitter de ses dettes était indissociable de s’acquitter de ses obligations sociales ; Cela faisait écho aux principes d’équité et de gratitude.
Les associations morales liées aux acquittements de dettes nous accompagnent encore aujourd’hui, et sont à la base de la logique d’austérité et du code juridique. Un bon pays, ou une bonne personne, est censée faire tout ce qui est en son pouvoir pour rembourser ses dettes. Par conséquent, si un pays comme la Jamaïque ou la Grèce, ou une municipalité comme Baltimore ou Detroit, ne possède pas assez de fonds pour rembourser ses dettes, il/elle se voit moralement contraint(e) de privatiser des biens publics, de diminuer retraites et salaires, de liquider des ressources naturelles, et de réduire les services publics, afin d’utiliser les économies engendrées pour rembourser ses créditeurs. Une telle prescription prend pour acquise la légitimité de ses dettes.
Aujourd’hui, un mouvement naissant de résistance contre la dette émerge de la prise de conscience de l’iniquité de bon nombre de ces dettes. Manifestement, les plus iniques sont les prêts impliquant des pratiques trompeuses ou illégales — le genre de pratiques courantes dans les prémisses de la crise financière de 2008. Des bulles spéculatives aux prêts volontairement accordés à des emprunteurs non-qualifiés, en passant par les produits financiers incompréhensibles proposés aux gouvernements locaux, maintenus dans l’ignorance la plus totale vis-à-vis des risques, ces pratiques ont entraîné des milliards de dollars de coûts supplémentaires pour les citoyens comme pour les institutions publiques.
Un mouvement émerge pour défier ces dettes. En Europe, le réseau International Citoyen pour l’audit de la dette (ICAN) fait la promotion « d’audits citoyens de la dette », dans lesquels les activistes examinent les comptes des municipalités et autres institutions publiques pour déterminer quelles dettes sont le fruit de pratiques frauduleuses, injustes ou illégales. Ils essaient ensuite de persuader le gouvernement ou l’institution de contester ou de renégocier ces dettes. En 2012, des communes françaises ont déclaré qu’elles refusaient de payer une partie de leurs obligations de dette à la banque Dexia, récemment renflouée, en expliquant que ses pratiques trompeuses avaient engendré des augmentations de taux d’intérêt jusqu’à 13 %. Pendant ce temps-là, aux Etats-Unis, la ville de Baltimore a entrepris une poursuite en justice pour récupérer de l’argent perdu à cause du scandale des manipulations du Libor, des pertes qui sont peut-être de l’ordre du milliard de dollar.
Et le Libor n’est que la partie émergée de l’iceberg. A l’ère de la fraude financière généralisée, qui sait ce que des audits citoyens pourraient découvrir ? De plus, à une époque où la loi elle-même est la cible de manipulation par les intérêts financiers, pourquoi la résistance devrait-elle se limiter aux dettes impliquant des infractions ? Après tout, le crash de 2008 était la conséquence d’une profonde corruption systémique dans laquelle les produits dérivés « à risque » s’avéraient sans risques — pas en raison de leurs caractéristiques propres, mais en raison des renflouements du gouvernement et de la Réserve Fédérale, qui servaient, de fait, de garanties.
Les auteurs de ces “instruments financiers de destruction de masse” (comme Warren Buffett les appelle) furent récompensés, tandis que les propriétaires de maisons, d’autres emprunteurs, et les contribuables, se retrouvèrent avec des actifs sans valeurs et des dettes plus élevées encore.
Cela fait partie d’un contexte plus large de conditions économiques, politiques et sociales injustes, qui obligent l’emprunteur à s’endetter. Quand de telles injustices sont omniprésentes, toutes les dettes, ou la majeure partie d’entre elles, ne sont-elles pas illégitimes ? Dans de nombreux pays, des salaires en baisse et des services publics amoindris obligent pratiquement les citoyens à s’endetter ne serait-ce que pour maintenir leur niveau de vie. La dette est-elle légitime lorsqu’elle est systématiquement imposée à la vaste majorité des gens et des nations ? Si ce n’est pas le cas, la résistance contre cette dette illégitime a d’immenses et profondes conséquences politiques.

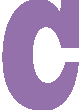 e sentiment d’injustice systémique généralisée est palpable dans le soi-disant monde en développement, et dans une partie croissante du reste du monde. Les nations africaines et sud-américaines, le Sud et l’Est de l’Europe, les communautés de couleur, les étudiants, les propriétaires avec emprunts, les municipalités, les chômeurs… la liste de ceux qui croulent sous une dette énorme, sans l’avoir choisi, est sans fin. Ils partagent le sentiment que leurs dettes sont en quelque sorte injustes et illégitimes, même si ce sentiment ne se base pas sur la jurisprudence. C’est pourquoi le slogan qui se propage chez les activistes de la dette et les résistants à travers la planète est le suivant :« Nous ne devons rien, nous ne paierons rien ».
e sentiment d’injustice systémique généralisée est palpable dans le soi-disant monde en développement, et dans une partie croissante du reste du monde. Les nations africaines et sud-américaines, le Sud et l’Est de l’Europe, les communautés de couleur, les étudiants, les propriétaires avec emprunts, les municipalités, les chômeurs… la liste de ceux qui croulent sous une dette énorme, sans l’avoir choisi, est sans fin. Ils partagent le sentiment que leurs dettes sont en quelque sorte injustes et illégitimes, même si ce sentiment ne se base pas sur la jurisprudence. C’est pourquoi le slogan qui se propage chez les activistes de la dette et les résistants à travers la planète est le suivant :« Nous ne devons rien, nous ne paierons rien ».
La remise en question de ces dettes ne peut pas se baser sur des appels au respect de la loi seuls, lorsque les lois sont biaisées en faveur des créanciers. Il y a, cependant, un principe légal pour remettre en question les dettes soi-disant légales : le principe de la « dette odieuse« . Signifiant originellement que la dette avait été octroyée au nom d’une nation par ses dirigeants, mais ne bénéficiait en réalité pas à la nation, ce concept peut être transformé en un puissant outil de changement systémique.
La dette odieuse était un concept clé de récents audits de dette au niveau national, notamment celle de l’Équateur en 2008 qui a entraîné un défaut de paiement de milliards de dollars de sa dette extérieure. Rien de terrible n’est arrivé, établissant un dangereux précédent (du point de vue des créanciers). La commission pour la vérité sur la dette publique Grecque analyse toute la dette souveraine de la nation avec cette même possibilité en tête. D’autres nations en prennent bonne note parce que leurs dettes, qui sont manifestement irremboursables, les condamnent à l’austérité pour l’éternité, à des baisses de salaires, à la liquidation de ressources naturelles, à la privatisation, etc., avec comme unique récompense le privilège de rester endetté (et de continuer à faire partie du système financier mondial).
Dans la plupart des cas, les dettes ne sont jamais remboursées. Selon un rapport de la campagne d’annulation de la dette Jubilé 2000, depuis 1970 la Jamaïque a emprunté 18,5 milliards de dollars, en a remboursé 19,8 milliards, et doit toujours 7,8 milliards. Sur la même période, les Philippines ont emprunté 110 milliards de dollars, en ont remboursé 125 milliards, et doivent toujours 45 milliards. Il ne s’agit pas là d’exemples isolés. Essentiellement, ce qui se passe ici, c’est que l’argent — sous la forme de force de travail et de ressources naturelles — est extrait de ces pays. Il en sort plus qu’il n’en arrive, en raison des taux d’intérêts qui accompagnent tous ces prêts.
Quelles sont les dettes “odieuses”? Quelques exemples sont évidents, comme les prêts pour la construction de la tristement célèbre centrale nucléaire de Bataan dont les acolytes de Westinghouse et Marcos ont énormément bénéficié mais qui n’ont jamais produit d’électricité, ou les dépenses militaires des juntes du Salvador et de la Grèce.
Mais qu’en est-il de l’immense dette ayant servi au financement des grands projets de développement centralisés? L’idéologie néolibérale prétend que cela se fait au bénéfice de la nation, mais il est aujourd’hui clair que les principaux bénéficiaires sont les corporations des nations prêteuses. De plus, la majeure partie de ce développement sert à permettre au receveur de mettre en place des exportations grâce à l’ouverture des marchés du pétrole, des minerais, du bois, ou d’autres ressources à exploiter, ou en convertissant l’agriculture vivrière en agro-business, ou en rendant sa force de travail disponible pour le capital mondial. Le commerce extérieur que cela génère sert au remboursement des prêts, mais les gens n’en bénéficient pas nécessairement. Ne pourrions-nous pas dire, par conséquent, que la majeure partie de la dette du monde « en développement » est odieuse, et le produit de relations coloniales et impérialistes ?
La même chose est vraie pour les municipalités, les foyers, et les dettes personnelles. Les lois fiscales, la dérégulation financière, et la mondialisation économique ont siphonné l’argent entre les mains des corporations et des super-riches, forçant tous les autres à emprunter pour subvenir aux besoins les plus élémentaires. Les municipalités et les gouvernements régionaux doivent maintenant emprunter pour fournir les services que les recettes fiscales finançaient autrefois, avant que l’industrie ne se soit enfuie vers des endroits où la régulation et les salaires étaient affaiblis, dans un « nivellement par le bas » mondial. Les étudiants doivent maintenant emprunter pour s’inscrire dans des universités autrefois fortement subventionnées par le gouvernement.
La stagnation des salaires oblige les familles à emprunter pour vivre. L’augmentation constante de dettes ne peut pas s’expliquer par une augmentation de la flemmardise ou par l’irresponsabilité. La dette est systémique et inévitable. Elle n’est pas juste, et les gens le savent. Plus le concept de dettes illégitimes se propagera, plus la contrainte morale liée au remboursement s’estompera, et de nouvelles formes de résistance contre la dette émergeront. Il en existe d’ailleurs déjà dans les endroits les plus affectés par la crise économique, comme l’Espagne, où un puissant mouvement anti-expulsion défie la légitimité de l’endettement hypothécaire, et vient de faire élire une maire activiste à Barcelone.
Comme nous l’a montré la récente tragédie Grecque, cependant, les actes isolés de résistance sont facilement écrasés. En faisant front seule, la Grèce faisait face à un choix difficile : soit capituler devant les institutions Européennes et mettre en place des mesures d’austérité encore plus sévères que celles que son peuple avait rejetées lors du référendum, soit subir la destruction soudaine de ses banques. Dès lors que ce dernier choix aurait entraîné une catastrophe humanitaire, le gouvernement Syriza a choisi de capituler. Néanmoins, la Grèce a rendu un fier service au monde en exposant clairement l’esclavage que représente ce concept de dette, et le fait que des institutions antidémocratiques comme la Banque Centrale Européenne contrôlent totalement les politiques économiques nationales.

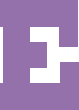 n plus d’une résistance directe, les gens découvrent des modes de vie en dehors du système financier conventionnel, et, ce faisant, préfigurent ce qui pourrait le remplacer. Des monnaies complémentaires, des banques de temps, des coopératives de fermes qui font le lien direct entre producteurs et consommateurs, des coopératives d’aide juridique, des réseaux d’économies du don, des bibliothèques d’outils, des coopératives médicales, des coopératives de garde d’enfants, et d’autres formes de coopération économique prolifèrent en Grèce et en Espagne, évoquant, dans bien des cas, des formes traditionnelles de communautarismes qui existent encore dans les sociétés qui ne sont pas encore entièrement modernisées.
n plus d’une résistance directe, les gens découvrent des modes de vie en dehors du système financier conventionnel, et, ce faisant, préfigurent ce qui pourrait le remplacer. Des monnaies complémentaires, des banques de temps, des coopératives de fermes qui font le lien direct entre producteurs et consommateurs, des coopératives d’aide juridique, des réseaux d’économies du don, des bibliothèques d’outils, des coopératives médicales, des coopératives de garde d’enfants, et d’autres formes de coopération économique prolifèrent en Grèce et en Espagne, évoquant, dans bien des cas, des formes traditionnelles de communautarismes qui existent encore dans les sociétés qui ne sont pas encore entièrement modernisées.
La dette est un problème très mobilisateur en raison de son omniprésence et de sa gravité psychologique. Contrairement au changement climatique, qu’il est facile de reléguer à une importance uniquement théorique quand, après tout, les supermarchés sont encore pleins de nourriture et que l’air conditionné fonctionne encore, la dette affecte les vies d’un nombre croissant de personnes directement et incontestablement : c’est un joug, un fardeau, une contrainte permanente sur leur liberté. Les trois quarts des états-uniens sont endettés, sous une certaine forme. La dette étudiante s’élève à plus d’1,3 billions de dollars aux USA et environne les 33 000 dollars par étudiant diplômé. Les municipalités du pays éviscèrent les services qu’elles fournissaient, licenciant des employés, et diminuant les retraites. Pourquoi ? Pour rembourser leurs dettes. La même chose est vraie au niveau de nations entières, à mesure que les créanciers — et les marchés financiers dont ils se servent — resserrent leur étau mortel sur le Sud de l’Europe, sur l’Amérique du Sud, sur l’Afrique, et sur le reste du monde. La plupart des gens n’ont pas besoin de beaucoup pour être convaincus que la dette est devenue un tyran dirigeant leurs vies.
Ce qui leur est plus difficile de comprendre, cependant, c’est qu’ils pourraient très bien être libérés de leurs dettes, qu’on leur présente souvent comme « inéluctables » ou « écrasantes ». C’est pourquoi les plus modestes remises en questions de la légitimité de la dette, comme les audits citoyens mentionnés plus haut, ont des implications révolutionnaires. Elles font douter de la certitude de la dette. Si une dette peut être annulée, peut-être peuvent-elles toutes l’être — non seulement pour les nations, mais pour les municipalités, les secteurs scolaires, les hôpitaux, et les gens aussi. C’est pourquoi les autorités européennes ont fait de la Grèce un exemple si humiliant — elles avaient besoin de réaffirmer le principe de l’inviolabilité de la dette. C’est aussi pourquoi des centaines de milliards de dollars ont été utilisés pour renflouer les créanciers qui avaient fait de mauvais prêts lors des prémisses de la crise financière de 2008, et c’est aussi pourquoi pas un centime ne fut dépensé pour renflouer les emprunteurs.
Non seulement la dette a le potentiel pour être un point de ralliement quasi-universel, mais elle est aussi un point de pression politique unique en son genre. Car, les conséquences d’une résistance massive contre la dette seraient catastrophiques pour le système financier. L’effondrement de Lehman Brothers en 2008 a prouvé le niveau extrême d’endettement du système, et son interdépendance telle qu’une petite perturbation peut se transformer en crise systémique massive. De plus, « nous ne paierons rien » est une forme de contestation facilement accessible pour le citoyen digital atomisé, et ayant un impact important dans le monde réel. Aucune manifestation de rue n’est nécessaire, aucune confrontation avec la police anti-émeute, pour empêcher le paiement d’une carte de crédit ou d’un prêt étudiant. Le système financier est vulnérable à quelques millions de clics. Ici repose la résolution d’un dilemme posé par Silvia Federici dans le trimestriel South Atlantic : « Au lieu du travail, de l’exploitation, et par-dessus tout des « patrons », si importants dans le monde des écrans de fumée, nous avons maintenant des débiteurs qui affrontent non pas un employeur mais une banque, et qui la confrontent seuls, et pas en tant que partie d’un organe collectif et de relations collectives, comme c’était le cas avec les travailleurs salariés. » Alors organisons nous et diffusons, autant que possible, ces messages de sensibilisation. Nous n’avons pas besoin d’affronter les banques, les marchés obligataires, ou le système financier, seuls.
Quel devrait-être le but ultime d’un mouvement de résistance contre la dette? La nature systémique du problème de la dette implique qu’aucune des propositions politiques réalistes ou atteignables dans le contexte politique actuel ne valent le coup d’être poursuivies. La réduction des taux sur les prêts étudiants, les allègements d’hypothèques, la régulation des salaires, ou la réduction de la dette des pays du Sud sont peut-être des propositions politiquement réalisables, mais atténuer les pires abus du système ne rendrait le système qu’à peine plus tolérable, et cela signifierait que le système n’est pas le problème — qu’il nous suffit de résoudre ces problèmes d’abus.
 es stratégies redistributrices conventionnelles, comme l’augmentation du taux marginal d’impôt sur le revenu, sont aussi limitées, principalement parce qu’elles ne s’attaquent pas aux causes profondes de la crise de la dette : le ralentissement de la croissance économique mondiale, ou, pour parler en termes marxistes, la baisse du rendement du capital. De plus en plus d’économistes rejoignent une grande lignée, incluant Herman Daly, E.F. Schumacher, et même (bien que cela soit assez méconnu) John Maynard Keynes, dans l’affirmation selon laquelle nous approchons de la fin de la croissance — principalement, mais pas seulement, pour des raisons écologiques. Lorsque la croissance stagne, les opportunités de prêts disparaissent. Puisque l’argent est principalement créé par l’emprunt, les niveaux des dettes augmentent bien plus rapidement que la masse monétaire nécessaire à leurs remboursements. La conséquence, clairement décrite par Thomas Piketty, en est la hausse de l’endettement et la concentration de la richesse.
es stratégies redistributrices conventionnelles, comme l’augmentation du taux marginal d’impôt sur le revenu, sont aussi limitées, principalement parce qu’elles ne s’attaquent pas aux causes profondes de la crise de la dette : le ralentissement de la croissance économique mondiale, ou, pour parler en termes marxistes, la baisse du rendement du capital. De plus en plus d’économistes rejoignent une grande lignée, incluant Herman Daly, E.F. Schumacher, et même (bien que cela soit assez méconnu) John Maynard Keynes, dans l’affirmation selon laquelle nous approchons de la fin de la croissance — principalement, mais pas seulement, pour des raisons écologiques. Lorsque la croissance stagne, les opportunités de prêts disparaissent. Puisque l’argent est principalement créé par l’emprunt, les niveaux des dettes augmentent bien plus rapidement que la masse monétaire nécessaire à leurs remboursements. La conséquence, clairement décrite par Thomas Piketty, en est la hausse de l’endettement et la concentration de la richesse.
Les propositions politiques précédemment mentionnées présentent également un autre défaut: elles sont tellement modérées qu’elles n’ont que très peu de chance d’inspirer un mouvement populaire massif. La réduction des taux d’intérêts, et les autres réformes incrémentales, ne vont pas stimuler une masse de citoyens apathiques et désillusionnés. Rappelez-vous du mouvement Nuclear Freeze des années 1980 : largement décrié comme naïf et irréaliste par les libéraux au pouvoir, il a généré un mouvement bruyant et engagé qui a contribué à la formation de l’opinion climatique à l’origine des accords START de l’ère Reagan. Le mouvement pour les réformes économiques a besoin de quelque chose d’aussi simple, compréhensible, et attrayant. Pourquoi pas l’annulation de la totalité de la dette étudiante ? Pourquoi pas un jubilé, un nouveau départ pour les débiteurs hypothécaires, les débiteurs étudiants, et les nations débitrices ?
Le problème c’est que l’annulation des dettes implique la suppression des actifs sur lesquels repose la totalité de notre système financier. Ces actifs sont à la base de votre fond de pension, de la solvabilité de votre banque, et du compte épargne de votre grand-mère. En effet, un compte épargne n’est rien d’autre qu’une dette que vous doit votre banque. Pour éviter le chaos, une entité doit acheter les dettes contre de l’argent, puis annuler ces dettes (dans leur totalité, ou en partie, ou réduire le taux d’intérêt à zéro). Il existe heureusement des alternatives plus radicales et plus élégantes aux stratégies redistributrices conventionnelles. Les deux plus prometteuses : « la monnaie honnête » et la monnaie fondante.
Ces deux alternatives impliquent un changement fondamental dans le processus de création monétaire. La monnaie honnête se réfère à la monnaie directement créée sans dette par le gouvernement, qui peut être directement donnée aux débiteurs pour le remboursement de la dette ou utilisée pour racheter des dettes aux créanciers, puis les annuler. Les monnaies fondantes (que je décris plus en détail dans « Sacred Economics ») impliquent des frais de liquidité sur les réserves bancaires, taxant essentiellement la richesse à sa source. Cela permet des prêts à taux zéro, cela réduit la concentration de la richesse, et cela permet à un système financier de fonctionner même en l’absence de croissance.
Les propositions radicales comme celles-ci ont en commun de reconnaître que l’argent, comme la propriété et la dette, est une construction sociopolitique. C’est un accord social dont la médiation se fait à l’aide de symboles : des chiffres sur des bouts de papier, des bits dans des ordinateurs. Ce n’est pas une caractéristique immuable de la réalité à laquelle nous ne pouvons que nous adapter. Les accords que nous appelons argent et dette peuvent être changés. Cela requiert cependant un mouvement de contestation de l’immutabilité du système actuel et l’exploration d’alternatives.
Charles Eisenstein
La source en français ici

