 Qu'est-ce que s'informer?
Qu'est-ce que s'informer?
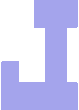 'ai lu aujourd'hui que GOOGLE allait participer à la lutte contre les fausses informations et les sites conspirationnistes. Je me suis demandé quel type d'algorithme allait bien pouvoir faire le tri entre le vrai et le faux, et sur quels critères il s'appuierait pour décider que tel site est ou n'est pas conspirationniste. Et en premier lieu, qu'est-ce qu'un site conspirationniste, comment s'assurer qu'une information est fausse?
'ai lu aujourd'hui que GOOGLE allait participer à la lutte contre les fausses informations et les sites conspirationnistes. Je me suis demandé quel type d'algorithme allait bien pouvoir faire le tri entre le vrai et le faux, et sur quels critères il s'appuierait pour décider que tel site est ou n'est pas conspirationniste. Et en premier lieu, qu'est-ce qu'un site conspirationniste, comment s'assurer qu'une information est fausse?
Car le citoyen avide d'information, soucieux de comprendre, analyser l'actualité afin de se faire l'idée la plus précise possible du monde dans lequel il évolue a aujourd'hui bien du mal à s'y retrouver. Et ce ne sont pas les velléités apparemment généreuses du géant de l'internet qui vont apporter la clarté.
Car enfin, ne soyons pas naïfs. Qui nous garantit que le moteur de recherche n'en profitera pas pour faire disparaître de nos écrans tout ce qui ne serait pas conforme à une opinion prédéfinie. Et si tout ce qui n'est pas utile ou acceptable par les puissants devenait tout bonnement un fake ou une théorie conspirationniste. Facile et efficace. Tout ce qui n'est pas dans les clous est rejeté.
Celui qui souhaite aujourd'hui résister à l'entreprise généralisée de désinformation est pour le moins démuni.
C'est pour lancer ce débat ou inciter au moins à la réflexion que je vous propose cet intéressant article.
Qu’est-ce que s’informer ?
 u’y a-t-il de commun entre une organisation complexe dotée de gros ordinateurs et de gros budgets et un animal préhistorique à gros corps et petit cerveau ? Ceci : ils doivent s’informer pour survivre. Qu’il s’agisse de se nourrir, de copuler pour se reproduire ou de conquérir des marchés planétaires, nul ne peut se contenter de réagir
u’y a-t-il de commun entre une organisation complexe dotée de gros ordinateurs et de gros budgets et un animal préhistorique à gros corps et petit cerveau ? Ceci : ils doivent s’informer pour survivre. Qu’il s’agisse de se nourrir, de copuler pour se reproduire ou de conquérir des marchés planétaires, nul ne peut se contenter de réagir
à des signaux, : il faut aller en quête d’information. Donc rechercher, percevoir et interpréter les différences (dans l’environnement) qui font une vraie différence (pour
notre comportement et son succès). En d’autres termes, même si votre entreprise est dotée de merveilleux outils de data mining, de logiciels sémantiques ou de knowbots qui explorent le Web invisible de long en large, même si votre structure distingue finement une fonction de veille concurrentielle, de veille brevet, de veille sociétale…, elle doit résoudre une question simple : comment acquérir des connaissances vraies et pertinentes. Exactement comme un gastéropode.
- Acquérir implique un effort. S’informer coûte. Certes de l’argent : la documentation ou les « nouvelles » (au sens de la presse) ne sont pas gratuites. Mais cela coûte surtout du temps et de l’effort de cerveau humain. Cet « effort » peut d’ailleurs être pénible psychologiquement, voire infliger des blessures narcissiques, si nous avons l’honnêteté de critiquer nos préjugés et nos biais cognitifs. Par définition l’information nouvelle contraste avec celle que nous possédions déjà, elle se distingue du déjà-vu et du déjà su (sinon c’est de la redondance). Pour la conquérir, il faut renoncer au confort du rassurant et de l’évident. Il faut faire son deuil de la facilité et de la séduction inhérentes à tout ce qui flatte nos stéréotypes et nos préconceptions. Souvent l’information neuve empêche ce que la relation communautaire rend si agréable : penser comme ses ancêtres, comme ses voisins, comme ses camarades ; elle gâche le plaisir de se redire ce qui nous réunit. Elle complique ce que l’idéologie rend trop évident (les réponses précèdent les questions). Il faut un effort mental minimum pour intégrer ce qui est significatif, replacer l’information dans un contexte, la recadrer par rapport à ce que nous savons déjà. Au final le terminal ultime – notre cerveau – a une capacité et un temps limités pour accomplir toutes ces tâches, ce qui veut dire que notre quête connaîtra, elle aussi, des limites. À noter qu’acquérir ne veut pas toujours dire mémoriser, ni même stocker, que ce soit sous forme d’un livre ou d’un document dans un disque dur. Il y a trois façons d’acquérir et conserver l’information : la confier à ses neurones, l’externaliser à un emplacement de stockage (tel un livre dans sa bibliothèque où l’on saura la retrouver à son gré), l’externaliser dans un flux d’informations que l’on a cartographié. Cela consistera par exemple la laisser sur Internet en ayant repéré son mode d’accès, c’est-à-dire en ayant repéré assez de métainformation (quel type de document, sur quel site, par quels mots clefs, dans le cadre de quelle recherche) pour repérer l’information.
- Des connaissances, cela veut dire que le processus de l’information n’est parachevé ni quand cette dernière est disponible sous forme de données stockées quelque part
(comme dans un disque dur), ni quand elle circule sous forme de messages, mais quand elle est littéralement in-formée, mise en forme. Donc devenue connaissance. Une connaissance suppose à la fois un contraste (par rapport à un fond, à un contexte, à une norme…) et un système de référence (ne serait-ce que celui de la langue) qui lui donne sens. Elle émerge quand l’information est interprétée, contribue à une représentation générale de la réalité, et appelle une réaction qualitative de l’interprétant. En clair : il n’y a pas d’information en soi, il y a toujours de l’information pour quelqu’un en particulier qui est dans un certain rapport au monde.
- « Vraies » : pose d’autres problèmes. Sans chercher à résoudre la question philosophique de l’essence de la vérité, disons qu’il faut considérer comme vraie une information à la fois vérifiable – cohérente avec l’ensemble de ce que nous pouvons comprendre, sanctionnée par l’expérience– et dont nous savons à quelles conditions elle pourrait être fausse. Ce dernier point (le principe de falsifiabilité en épistémologie) est particulièrement crucial si on tente de mener une anticipation : il est trop facile de trouver des signaux qui confirment l’hypothèse de départ. Par ailleurs, il faut bien comprendre ce qu’est une énonciation vérifiable et falsifiable. La phrase « Je suis belle, ô mortels, comme un rêve de pierre », n’est ni vraie ni fausse, ni vérifiable ni falsifiable : elle vaut par sa capacité d’évocation, pas par sa valeur probante. En revanche la phrase « Ceci est un vers de Charles Baudelaire » doit être considérée comme vraie, du moins tant qu’il n’aura pas été démontré que l’existence de l’auteur des Fleurs du mal est un gigantesque canular littéraire ou qu’il faisait écrire ses poèmes par un complice.
- « Pertinentes » :suppose un rapport avec des besoins. Ces besoins sont le plus souvent ceux de l’action ou de la décision. La phrase « Le cours du pétrole finira bien par s’effondrer » est certainement vraie (du moins si l’on admet le principe que rien ne se prolonge à l’infini) mais elle ne nous est pas très utile sans précision de date : dans six mois ou dans trente ans ? Toute démarche d’information suppose donc quatre préalables:
- Une stratégie générale. Dans le domaine de l’intelligence économique, la veille est généralement définie comme la « détection de menaces et opportunités dans l’environnement ». Mais on ne peut détecter et interpréter tous les signaux.. Il faut hiérarchiser les veilles les structurer : quel type d’information formelle faut-il acquérir dans le domaine des brevets, de la prospective politique, de l’évolution de la législation communautaire, de la compréhension des courants intellectuels ou sociétaux émergents, par exemple ? La réponse diffère fortement suivant le type d’activité. Il faut donc commencer par bien concevoir ce que l’on a besoin de savoir.
- Une analyse des risques informationnels. Elle répond à la question complémentaire «Que ne puis-je me dispenser de savoir ? » Ceci implique à la fois d’analyser - quel type d’information on ne peut se permettre de perdre ou de voire altérée, - quelle information on ne peut se permettre de laisser diffuser ou circuler, - et quels signaux peuvent annoncer une crise grave ou insupportable. Toute procédure de communication de crise cohérente repose forcément sur cette démarche. Sauf à se condamner à la paranoïa galopante (s’attendre à tout, redoubler toutes les procédures de sécurité, revérifier ce qui a été vérifié, tout tester…)
- Une évaluation des besoins et moyens d’information. Ceci suppose de fixer un coût supportable (en termes de financement, de personnel, de temps, d’énergie) par rapport à un résultat attendu. Cette démarche doit également distinguer ce que l’on doit faire directement et de ce qu’il est possible de mutualiser, d’externaliser, de sous-traiter…, en matière d’information. Il est souvent inutile de réinventer la roue et de se doter d’une base de données hyper-complexe, là où une bonne revue de presse suffirait. A-ton des besoins de documentation si exceptionnellement pointue qu’aucune publication ou aucun centre de recherche bien connu ne puisse le satisfaire.
- Dernière étape l’organisation de sa propre procédure de traitement de l’information en s’inspirant par exemple du « cycle du renseignement » cher aux services du même nom. Cette terminologie sulfureuse recouvre en réalité des étapes simples et logiques :
- Savoir ce que l’on cherche à savoir (idéalement sous forme d’une hypothèse à confirmer ou à infirmer pour prendre une décision),
- Savoir quand il faut savoir (être en attente de toutes les données ou de toutes les confirmations peut mener au fameux processus de régression à l’infini et surtout à l’indécision stratégique),
- Savoir où savoir (identifier les sources utiles) - Mais aussi savoir ce que l’on sait. Ceci implique notamment d’analyser l’information, d’extraire de tout le bruit des données
recueillies, de qualifier la valeur de ces éléments, de les replacer dans un contexte, d’en tirer les conséquences éventuelles, d’en faire un véritable élément d’anticipation et surtout de choix pour un décideur.
- Enfin il faut faire savoir c’est-à-dire faire parvenir l’information à la personne juste, sous la forme juste, au moment juste où elle en aura besoin.
- Finalement, le cycle tend à se relancer de lui-même : ce que nous savons nous aide à préciser ce que nous devrions savoir. Par exemple à formuler une hypothèse plus précise sur l’avenir. Tout ce qui précède peut s’appliquer à une entreprise, à une bureaucratie, à une collectivité, mais aussi à un individu : un étudiant préparant un mémoire ou un citoyen, désireux de ne pas mourir idiot et de comprendre quelque chose en politique ou en économie, La conséquence la plus évidente est que s’informer consiste à passer des compromis.en fonction de critères du raisonnable ou du vraisemblable (choix qu’il sera toujours impossible de déléguer à un logiciel ou à une procédure). S’informer consiste donc à certains égards à concilier des critères inconciliables, ou du moins, à fixer l’aiguille à un point raisonnable entre deux pôles.
_ Le couple le plus évident est : quantité de données (ou du moins surinformation, risque de plus en plus présent sur Internet) et spécificité de la demande (phénomène bien connu : plus une requête est précise, plus elle accumule de critères, sélectifs, moins elle a de chances d’être satisfaite).
_ Mais aussi : communicabilité, (au sens de ce qui se partage aisément, est communément admis, se reçoit spontanément, ce qui correspond aux stéréotypes, ce qu’il est agréable de croire…) versus valeur novatrice de l’information.
_ Il faut également choisir entre la normalisation de la recherche et son individualisation. Dans le premier cas, le Charybde serait la démarche unique aboutissant à des résultats standards (voire même sur Internet, à une « pensée copier-coller » qui consiste à s’approprier un texte tout fait). Quant au Sylla, ce serait ici l’adoption de critères arbitraires valorisant systématiquement l’information « marginale » voire délirante mais qui correspond à des phantasmes propres au chercheur (comme les maniaques des soucoupes volantes qui arrivent à trouver des centaines d’indices de la présence des OVNI parmi nous et des contradictions dans tous les « déclarations officielles »).
Nous verrons aussi qu’il faut dans certaines circonstances choisir de privilégier l’information pure (des énonciations relatives à la réalité) ou la métainformation (tout ce qui permet de comprendre la genèse, la logique ou la valeur de celle qui précède). Mais ces compromis prennent un sens très différent suivant le mode de recherche de l’information.
Chacun doit plus ou moins maîtriser la technique de la documentation de type classique (correspondant grosso modo à une méthode de recherche telle qu’un bon bibliothécaire l’enseignerait à un débutant) l’utilisation des réseaux humains (très vaste domaine qui va de l’espionnage à la façon de demander des tuyaux à ses relations), mais il faut aussi apprendre à s’adapter au flux médiatique. Enfin et surtout, il faut maîtriser les nouvelles règles propres l’univers numérique, leurs immenses possibilités mais aussi les nouvelles dépendances...
Le monde de l‘imprimé : le rêve encyclopédique.
La recherche d’information dans le monde de l’imprimé, la galaxie Gutenberg chère à Mc Luhan – ou, si l’on préfère, dans la graphosphère (milieu technique dominé par l’imprimerie, période qui commence au XV° siècle et s’achève dans la seconde partie du XX° avec le triomphe de l’audiovisuel ) est une expérience familière pour la plupart d’entre nous.
Nous avons passé des années d’école à apprendre à lire, à choisir et interpréter un livre ou un article, à l’évaluer, à en discuter avec d’autres lecteurs. Nous sommes nés (au
moins pour les, dinosaures gutenbergiens comme l’auteur de ces lignes) avec l’habitude de considérer la vie intellectuelle comme conversation silencieuse avec des personnes vivantes ou mortes via des textes écrits. Nous avons connu un monde ordonné, rassurant : de l’instituteur à l’école primaire au bibliothécaire (diplômé en sciences de la recherche et documentation), en passant par la critique littéraire de notre quotidien favori ou par la revue de presse de notre entreprise ou notre administration, tout le système n’avait qu’un but apparent : nous aider à trouver le « bon » document. Dans ce paradis perdu, tout était ordonné et rassurant. Le texte contenant la réponse à notre question (de la recherche d’une donnée factuelle ou d’une interrogation métaphysique) devait se trouver quelque part, fixée pour plusieurs générations, sous forme matérielle : livre, revue, journal, rapport classé et protégé. À ce texte devaient s’ajouter après coup des métatextes : des discours a son propos, tels une critique littéraire ou une interview de l’auteur. Chaque texte était clairement attribuable. Le contenu était clairement séparé de son support et de son langage. Le texte avait un auteur -un individu ou un collectif comme « la Rédaction » ou « le comité Théodule » - qui, souvent en avait produit plusieurs versions et avait décidé à un moment de «figer » des capsules de sens encloses par le bon à tirer, le n° d’édition.. Ce contenu était alors devenu des traces matérielles (de l’encre fixée mécaniquement sur du papier) transportées, stockées et offertes au public ou à un public restreint suivant des procédures canoniques.
La garde du trésor était confiée à des professionnels et à leurs territoires : librairies, archives, bibliothèques, quelque part, solidement bâties. Chaque bibliothèque était régie par un ordre explicite : romans, essais, périodiques, annuaires et dictionnaires… Sa structure reflétait celle de la connaissance telle qu’on la rêvait au temps des Lumières, voire la structure d’une Encyclopédie : un arbre du savoir. Des grandes branches (physique, histoire, sciences humaines..) des sous-branches (sociologie, sociologie urbaine, sociologie des médias….).
De plus le papier imprimé survivait dans un milieu culturel et institutionnel voué à sa reproduction et fondé sur sa légitimité : École, académies, République des lettres… Dans ces univers, des monades, les textes, étaient abritées par ces institutions qui étaient comme leur biosphère. Celles-ci ne remplissaient pas seulement une fonction de conservation, mais aussi d’accréditation. Le livre, ou l’article affrontait l’épreuve du temps parce qu’en amont, il avait déjà été sélectionné. Rédacteurs en chef, comités de rédaction, directeurs de collection, comités scientifiques, puis libraires et bibliothécaires avaient déjà effectué un premier écrémage (droit d’être publié, droit d’être conservé ou exposé) . Ils se conjuguaient au droit d’être célébré que lui accordaient ou non les critiques (revues et journaux, communautés des pairs : scientifiques, universitaires, gens de lettres, commentateurs, thésards…).
Parvenus à destination, les livres ou publications faisaient l’objet d’une disposition matérielle : rangement dans telle section avec telle cote ou sur tel rayonnage. Des professionnels en faisaient aussitôt la cartographie, au moins dans les institutions de conservation comme les bibliothèques. Suivant des règles formalisées (présentation du
titre, édition, année, catégories Dewey, mots-clés), des strates entières de traces laissées par des auteurs se disposaient à leur place comme prédestinée : telle pièce, tel rayon, telle cote. Et, en principe, notre mémoire commune ne cessait de s’accroître. Le lecteur, lui, se laissait guider par plusieurs habitudes lentement acquises et souvent par des connaissances implicites.
La décision de lire ou pas (d’acheter le journal, d’emprunter le livre…) se faisait à l’issue d’une brève délibération impliquant dans des proportions variables :
- Des considérations purement pratiques : coût ; temps de lecture, éloignement physique du lieu de stockage du texte (du kiosque au coin de la rue à la Bibliothèque Nationale pour un chercheur de province)
- La relation de confiance acquises au fil de la pratique : telle bibliothèque était riche, tel éditeur sérieux, telle collection orientée sur tel courant intellectuel, tel auteur fiable, tel quotidien « de référence », « bien informé » ou du moins conforme aux « valeurs » du lecteur.
- Un système de réputation : lecture de la critique, conseils d’amis, de libraires, de bibliothécaires, et souvent informations glanées à l’occasion de la conversation, cet art bien français. Cette réputation pouvait être renforcée par des recommandations, récompenses ou prix décernés par des institutions.
- L’usage d’équivalents littéraires des cartes et portulans : les catalogues et bibliographies pour guider un trajet de lecture. Quand le système de repérage et classification faisait appel à des éléments dits « métatextuels » comme les mots clés, ceux-ci étaient rares et sélectionnés suivant des règles communs.
- Le résultat d’un premier contact physique avec le livre ou la publication. Ce contact prenait souvent la forme d’un rituel ou d’un itinéraire propre à chaque lecteur. Albert lit systématiquement la première et la dernière phrase. Béatrice picore des morceaux de texte. Claude regarde l’index, la bibliographie et les notes, pour vérifier le sérieux de l’auteur. Denise devant un journal, feuillette, regarde les titres, les chapôs, les photos, et se décide pour un article. Etc. Souvent ce « contact physique » se résume en un coup d’oeil : la couverture du livre, le titre, la typographie du journal et sa mise en page, son illustration suffisent à déclencher la décision d’achat, ou du moins, celle de feuilleter.
- Enfin le texte est évalué en fonction de ce que les sémiologues appelleraient sa transtextualité (tout ce qui met un texte en rapport avec d’autres). En clair, le lecteur évalue en fonction d’autres lectures qui lui permettent de mieux interpréter le texte-clef :
-citations (ou parodies ou allusions à) d’autres textes,
- appareil entourant le texte même (titres, sous-titres, critique, préface, notes),
-autres textes auquel le texte lu fait allusion sans nécessairement les reproduire même en partie ( par exemple les phrases « les marxistes pensent que » ou « les éditorialistes néo-conservateurs soutiennent la guerre en Irak »),
-reprise sous une forme dérivée (développement ou, au contraire, simplification pédagogique, pastiche, critique) d’un texte antérieur,
-appartenance à une catégorie de textes (les éditoriaux du Monde, un livre de sciences humaines…).
A la fin et à la fin seulement du cycle, l’acquisition de l’information contenue dans le texte, chacun à sa façon propre : lecture de bout en bout, en diagonale, par picorage ou coups de sonde, annotée ou pas… Tel est le monde d’où nous sommes issus. Un monde dont –le lecteur commence à s’en douter – il faudra réviser toutes les règles depuis que nous vivons aussi dans la vidéosphère dominée par l’audiovisuel et dans l’hypersphère des informations numérisées et en réseau.
S’informer avec des images
Une image peut-elle produire un savoir ? À quelques exceptions près (comme les Encyclopédistes qui croyaient en sa vertu pédagogique et employaient planches et schémas pour se faire comprendre), les philosophes ont tendance à répondre par la négative. Ils tendent à opposer l’image qui hypnotise, qui séduit, qui réduit, etc; à la parole qui enseigne par contact avec sage ou à l’écrit qui permet la réflexion et ouvre un dialogue invisible mais stimulant avec le lecteur. Platon voulait bannir de sa cité idéale les peintres, les sculpteurs et tous ceux qui font de la mimésis, de l’imitation. Pour lui, l’idée de lit était supérieure au lit fabriqué par un menuisier, mais ce dernier était infiniment meilleur que le lit peint qui ne faisait que déformer la réalité et créer des illusions. L’image qui s’adresse aux sens est chatoyante, trompeuse… L’icône s’oppose au Logos.
Les religions n’ont pas non plus été tendres envers les fabricants d’images. Les mouvements iconoclastes, qui détruisaient les figurations religieuses ou profanes, se retrouvent à toutes les époques, et pas seulement dans les religions monothéistes. Parmi les reproches– être un acte démiurgique qui rivalise avec la création divine, favoriser l’idolâtrie en représentant de faux dieux, inciter aux plaisirs terrestres - il y a aussi le reproche d’insuffisance sémantique. Une image faite par un homme ne peut représenter l’essence d’un être omnipotent comme le Créateur, ou simplement la nature ineffable du Saint.
Quand l’image est devenue indicielle, c’est-à-dire quand est apparue la photographie qui est un enregistrement du réel et non sa reproduction par un main habile, ce fut un cri pour prophétiser la mort de l’art. Et quand l’image s’est animée, nombre de penseurs se sont mis à énumérer les dégâts psychiques qu’allait produire cette technique. Mais l’horreur de l’horreur, reste la télévision, cet objet que les intellectuels aiment haïr. Des membres de l’école de Francfort exilés aux USA sous le nazisme à Karl Popper, ou de Neil Postman à Pierre Bourdieu, de la gauche à la droite, au nom de la culture humaniste ou de la lutte des classes, les pamphlets ne se comptent plus. Umberto Eco avait même formé le mot d’apocalyptiques pour désigner tous ceux qui croient que „le média ne véhicule pas l’idéologie, il est l’idéologie “. Et il a parodié avec talent ces fulminations contre la manipulation du réel par les images télévisées ou ces descriptions du téléspectateur passif, amorphe, livré à la fascination d’un monde sans réalité fait pour l’entretenir dans ses rêves stéréotypés.
Rappelons cependant les principaux reproches faits à l’information télévisuelle :
- La hâte, le règne du vite filmé, vite diffusé, vite jugé, vite pensé. Donc l’absence de recul et de réflexion la tendance à recourir aux stéréotypes. Vite digéré, vite oublié. Cette hâte produit souvent une hystérie qui atteint à son tour les acteurs : il faut réagir pour le vingt heures, il faut annoncer une mesure spectaculaire…, en attendant que les caméras se détournent.
- Le flux d’images qui met tout sur le même plan : il écrase toute hiérarchie, tout sentiment de ce qui est vraiment important. Le spectaculaire l’emporte sur le significatif et le répétitif (ce à quoi s’intéressent les médias) sur l’informatif. Les images qui nous sont présentées ne sont qu’une infime partie de celles qui sont disponibles, ne serait-ce que celles des agences. Mais cette infime partie finit souvent par être sélectionnée selon les mêmes critères dans le même pays, si bien que l’on ne cesse de se repasser les mêmes séquences à peu près dans le même ordre, au même moment, et avec des commentaires similaires..
- La mise en scène de la réalité (avec acteurs identifiables, souvent bons et méchants, suspense, développement, dénouement…) a des effets pervers comme le développement de la polémique au détriment de la réflexion, la recherche du sensationnel ou la réduction du complexe.
- La fusion émotionnelle, le sentiment de vibrer ensemble, l’emportent sur la recherche du sens.
- La force du direct, le sentiment de participer, la séduction des grandes communions (nous vivons l’histoire tous ensemble, toute la planète vibre à ces images, regardez, vous êtes concernés..), la fusion émotionnelle, la prédominance de la communication / communion sur l’information/distanciation…
- Le formatage : pour simplifier, ratisser large et soutenir l’attention distraite du téléspectateur, on recourt aux lieux communs, aux simplifications, on emploie les mêmes ressorts, on classe tous dans des genres et catégories très répétitifs.
- L’effet d’anticipation : on filme ce qui intéresse ou concerne les „gens“. Mais comment sait-on ce qui „intéresse les gens“ ? est-ce ce que réclame l’Audimat, ce que le public a l’habitude de se voir proposer ou ce dont un groupe de décideurs (les „gardiens des portes“) ont décidé qu’il serait digne d’être porté à l’attention des „gens“ ? Et sur quels critères ?
- Le pas-vu devient facilement le pas su et le pas intéressant. Ce dont il n’existe pas d’images, nul n’en parle, ce n’est pas un objet de „débat“, donc on s’y intéresse de moins en moins et on cherche moins à en trouver de images. Donc…
- La tentation du pistacisme : les médias traitent de ce dont traitent les médias et en particulier d’eux-mêmes. Du coup, il peut se produire un effet emballement : on parle d’un sujet qui acquiert, par exemple, la dignité de symptôme d’époque ou de fait de société; puis on commente et on commente le commentaire du commentaire (le débat, la polémique) qui devient à son tour un phénomène éminent, digne d’être largement traité. Jusqu’à ce que la baudruche se dégonfle et que le sujet de société soit chassé par un sujet de société ou le problème par le problème (voir par exemple comment l’affaire de la grippe aviaire disparaît du jour au lendemain de l’actualité pour cause de CPE).
- La production de pseudo-événements (des événements qui ont été mis en scène pour passer à la télévision), de pseudo-personnalités (des gens qui sont bien connus pour être connus et dont la présence médiatique est liée à la visibilité médiatique antérieure) et de pseudo-commentaires (réflexions générales ou morales, généralement dans le registre de l’indignation, censées éclairer l’événement mais totalement prédictibles et absolument formatées pour passer et être assimilées dans le temps imparti). À noter que l’emballement peut partir d’un événement faux, mais que personne n’a pris le temps de vérifier ou n’a eu le courage de contester. Voir la prétendue agression antisémite dans le RER. Par ailleurs, les acteurs tendent de plus en plus à prendre des pseudo-décisions: effets d’annonce, plans de communication, mobilisation des tribunes, …
- En amont, la prédominance de l’image modifie les habitudes et les mentalités. Par exemple, la sélection de la classe politique se fait de plus en plus sur la télégénie. Les programmes tendent à se gommer au profit du marketing politique…
- Le trucage pur et simple : scènes jouées, situations provoquées, images traitées, désinformation. La technologie numérique le met à la portée de chacun.
- La semi-authenticité de l’image. Comment en douter, puisque la caméra n’a fait qu’enregistrer des évènements qui se déroulaient devant son objectif ? Pourtant, il faut rappeler quelques évidences : une image télévisée dépend de son commentaire, de son contexte et de son montage. C’est un lieu commun, mais il faut le répéter : elle est construite et son interprétation nous est sinon imposée, du moins proposée avec insistance.
- Les déficiences de l’image qui est d‘abord particularisante. Elle peut montrer une personne, une victime, un „jeune“ ou un „Iranien“ que l’on fera parler au nom d’une catégorie de gens, à qui on fera représenter le sort d’une communauté. Les sentiments que l’on éprouve à l’égard d’un individu visible ou d’une situation spectaculaire tendront à être généralisés. À la télévision on personnifie et on incarne, le fait est exemple et symptôme. Or l’image ne peut par définition représenter les abstractions (La République, la Justice) ni ce qui est absent, ni ce qui est conditionnel, ni ce qui est contradictoire. Donc rien de ce qui aide vraiment à comprendre le réel. La télévision tend à montrer des gens. Les gens sont sympathiques ou pas, ont l’air compétents, sincères, proches des préoccupations des gens, bon pédagogues ou pas. Malheureusement cela n’a rigoureusement rien à voir avoir la vérité de ce qu’ils énoncent ou la valeur de la cause qu’ils défendent ou avec le rôle de la catégorie qu’ils représentent.
- Le provincialisme paradoxal : bien que nous répétions sans cesse que les images ne connaissent pas de frontières et que les médias sont par excellence le domaine de la globalisation dans le village planétaire, les images que nous voyons dépendent fortement de nos cultures et de nos habitudes nationales. Rien de plus frappant que de comparer deux JT le même jour à la même heure dans deux pays européens : à se demander si nos vivons dans le même monde.
- Le journalisme télévisuel qui est souvent un journalisme de l’urgence – et qui, dans tous les cas n’a plus guère le temps et les budgets pour faire des enquêtes de fond- est de plus en plus dépendant des ses sources. Voire de ses fournisseurs d’images qui ne sont pas toujours désintéressé.
Faut-il continuer la liste ? On a presque honte de prétendre ajouter sa pierre, surtout si on s’adresse, comme ici, à un public qui se pose sérieusemet la question du „Qu’est-ce que s’informer ?“ et dont la première idée ne serait sans doute pas de se précipiter sur le JT pour comprendre en profondeur la marche du monde. Mais la réponse était peut-être dans la question : si nous nous immergeons si volontiers dans ces flux d’images, si nous en délectons, est-ce vraiment parce que nous voulons apprendre ce qui se passe ?
Ou parce que nous avons besoin de leur présence et de leur partage ?
S’informer dans l’univers numérique.
Pour lire la suite, aller sur le " site de François-Bernard huyghe,"
Ou télécharger le texte complet ici 

