 Plaidoyer juridique pour la suspension et la répudiation des dettes publiques
Plaidoyer juridique pour la suspension et la répudiation des dettes publiques
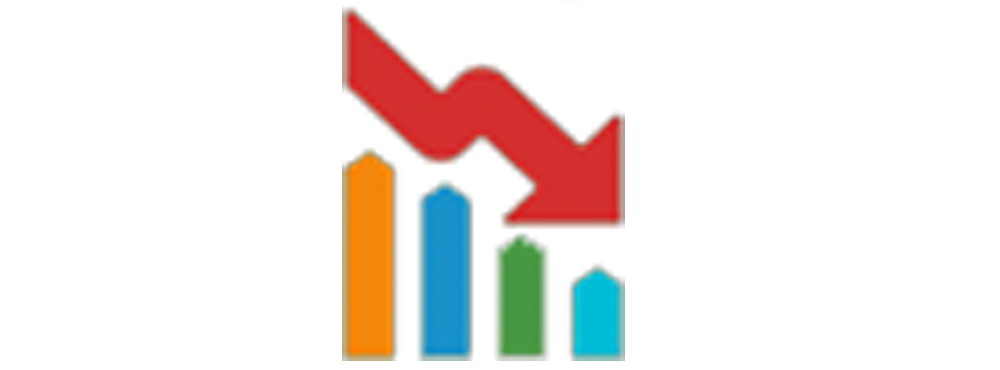
Renaud Vivien, Cécile Lamarque
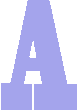 près les gouvernements du Sud à partir des années 1980, les gouvernements au Nord utilisent aujourd’hui l’alibi de la dette pour mettre en place des politiques d’austérité budgétaire, dont les similitudes avec les plans d’ajustement structurel (PAS) prônés par le FMI et la Banque mondiale sont nombreuses. Bien sûr, nous ne sommes pas opposés à des mesures d’austérité pour les détenteurs de capitaux, pour les spéculateurs, pour les hauts revenus, qui viseraient à garantir la justice sociale et le respect des droits économiques, sociaux et culturels (DESC) des populations. En ce sens, l’austérité souhaitée implique par exemple la réduction drastique des dépenses d’armement, la suppression des cadeaux fiscaux bénéficiant aux plus riches, une lutte énergique contre la grande fraude fiscale, la suppression des subventions et autres avantages financiers aux exportateurs, etc. Or, actuellement, les politiques de rigueur mises en oeuvre frappent uniquement les classes populaires en comprimant fortement les dépenses publiques dans des secteurs essentiels tels que la santé ou l’éducation, alors qu’il faudrait augmenter ces dépenses en les finançant par une augmentation de l’impôt sur les hauts revenus, sur les bénéfices des sociétés et sur les patrimoines élevés. Briser le cercle vicieux de la dette apparaît dès lors comme une nécessité politique, économique et sociale. Le droit international public |1| offre aux gouvernements qui en ont la volonté de solides arguments pour sortir du piège de la dette et des politiques antisociales d’inspiration néolibérale, que nous désignerons par « rigueur » ou « austérité ».
près les gouvernements du Sud à partir des années 1980, les gouvernements au Nord utilisent aujourd’hui l’alibi de la dette pour mettre en place des politiques d’austérité budgétaire, dont les similitudes avec les plans d’ajustement structurel (PAS) prônés par le FMI et la Banque mondiale sont nombreuses. Bien sûr, nous ne sommes pas opposés à des mesures d’austérité pour les détenteurs de capitaux, pour les spéculateurs, pour les hauts revenus, qui viseraient à garantir la justice sociale et le respect des droits économiques, sociaux et culturels (DESC) des populations. En ce sens, l’austérité souhaitée implique par exemple la réduction drastique des dépenses d’armement, la suppression des cadeaux fiscaux bénéficiant aux plus riches, une lutte énergique contre la grande fraude fiscale, la suppression des subventions et autres avantages financiers aux exportateurs, etc. Or, actuellement, les politiques de rigueur mises en oeuvre frappent uniquement les classes populaires en comprimant fortement les dépenses publiques dans des secteurs essentiels tels que la santé ou l’éducation, alors qu’il faudrait augmenter ces dépenses en les finançant par une augmentation de l’impôt sur les hauts revenus, sur les bénéfices des sociétés et sur les patrimoines élevés. Briser le cercle vicieux de la dette apparaît dès lors comme une nécessité politique, économique et sociale. Le droit international public |1| offre aux gouvernements qui en ont la volonté de solides arguments pour sortir du piège de la dette et des politiques antisociales d’inspiration néolibérale, que nous désignerons par « rigueur » ou « austérité ».
Fondements juridiques pour suspendre le paiement des dettes publiques
Rembourser la dette publique n’est pas une fatalité
Pour être lié par un contrat de prêt, l’État doit avoir donné librement son consentement. De ce consentement naît une relation juridique : l’obligation pour l’État de rembourser la dette qu’il a contractée. Cette obligation repose sur le principe pacta sunt servanda (les conventions doivent être respectées) consacré à l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 |2| et par le principe de continuité de l’État qui entraîne la transmission des dettes d’États d’un gouvernement à l’autre.
Néanmoins, ces principes ne sont pas absolus |3| et ne valent que pour « des dettes contractées dans l’intérêt général de la collectivité |4| ». Le point clé est donc « l’intérêt général de la collectivité ». Selon le droit international, l’évaluation de l’intérêt général et la détermination du caractère licite ou illicite de la dette relèvent de la compétence des pouvoirs publics |5|. La mise en place d’un audit des dettes publiques par les pouvoirs publics, associant des représentants de la « société civile » du pays, pour identifier ces dettes illicites est donc tout à fait légale.
La pratique des États confirme par ailleurs que le remboursement des dettes publiques ne constitue pas une obligation absolue. Dans un rapport de 2008 consacré à la doctrine de la dette odieuse rédigé à la demande de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) |6|, il est affirmé que l’obligation pour un État de rembourser les dettes n’a jamais été reconnue dans l’Histoire comme étant inconditionnelle. Son auteur énumère les nombreux précédents en faveur du non-paiement de certaines dettes frauduleuses et les règles juridiques qui limitent la portée du principe pacta sunt servanda,comme les principes généraux du droit international (PGD) : la bonne foi, l’équité, etc.
Comme le rappelait déjà en 1930 le gouvernement autrichien lors d’une réunion du Comité préparatoire à la Conférence pour la Codification du Droit International : « la doctrine dominante du droit des gens ne semble pas qualifier comme violation des obligations internationales d’un État la répudiation par cet État de ses dettes, à moins qu’il ne le fasse de façon arbitraire |7| ». Le CADTM rejoint cette position affirmant la licéité d’un acte unilatéral de répudiation (et a fortiori de suspension) de la dette fondé sur la protection des droits humains fondamentaux. Un tel acte n’est pas arbitraire, il dispose d’une base légale.
Par conséquent, il n’existe pas d’obligation inconditionnelle pour un État d’honorer ses dettes. Les gouvernements débiteurs et créanciers peuvent, sur le fondement du droit international, suspendre et répudier/annuler certaines dettes. Pour déterminer la part qui ne doit pas être payée, les pouvoirs publics peuvent mener un audit de leurs dettes. Au préalable, la suspension immédiate du paiement de la dette, avec gel des intérêts, peut s’avérer nécessaire et est tout à fait justifiée.
Une austérité à l’encontre des obligations relatives aux droits humains
L’article 103 de la Charte de l’ONU |8|, à laquelle les États membres des Nations unies doivent impérativement adhérer, est sans ambiguïté : « En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. » Parmi les obligations contenues dans cette Charte, on trouve notamment, aux articles 55 et 56, « le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social (…), le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». Cette Charte consacre également le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (article 1-2) et la coopération internationale pour le développement des peuples (article 1-3). Toutes ces dispositions destinées à protéger les droits humains priment donc sur les autres engagements pris par les États, parmi lesquels le remboursement des dettes, et aussi l’application des programmes d’austérité imposés notamment par le FMI, la Banque mondiale et la Commission européenne.
Les rapports de l’ONU rappellent régulièrement cet impératif de protection des droits humains fondamentaux. À titre d’exemple, la résolution du Conseil des droits de l’homme de l’ONU du 23 avril 1999 affirme que « l’exercice des droits fondamentaux de la population des pays débiteurs à l’alimentation, au logement, à l’habillement, à l’emploi, à l’éducation, aux services de santé et à un environnement salubre ne peut être subordonné à l’application de politiques d’ajustement structurel et de réformes économiques liées à la dette |9| ». En 2009, l’expert indépendant de l’ONU sur la dette externe, Cephas Lumina, ne disait pas autre chose en précisant que les textes internationaux de protection des droits humains s’imposent non seulement aux États mais également aux institutions internationales comme la Banque mondiale et le FMI.
Parmi ces textes, on trouve entre autres la Charte de l’ONU (1945), la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), les deux Pactes de 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et sur les droits civils et politiques (PIDCP), la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) ou encore la Déclaration sur le droit au développement (1986). Or, les politiques de rigueur appliquées au Sud et au Nord violent de façon flagrante ces différents engagements juridiques internationaux. Arrêtons-nous sur quelques exemples de telles violations au Sud et au Nord en relation avec l’endettement des États.
Depuis l’éclatement de la crise de la dette du tiers-monde en 1982, le FMI et la Banque mondiale contraignent les pays du Sud à appliquer des plans d’ajustement structurel pour rembourser leurs créanciers qui avaient pourtant prêté de manière totalement irresponsable et imprudente. Au menu : réduction des surfaces destinées aux cultures vivrières et spécialisation dans un ou deux produits d’exportation, fin des systèmes de stabilisation des prix, abandon de l’autosuffisance en céréales, fragilisation des économies par une extrême dépendance aux évolutions des marchés mondiaux, forte réduction des budgets sociaux, suppression des subventions aux produits de base, ouverture des marchés et mise en concurrence déloyale des petits producteurs locaux avec des sociétés transnationales, privatisation du secteur de l’eau, de la santé, de l’éducation, des entreprises stratégiques et des ressources naturelles, licenciements massifs dans la fonction publique, dérèglementation du code du travail pour rendre plus faciles les licenciements…
Entre autres conséquences néfastes, la souveraineté alimentaire et plus largement le droit à l’alimentation sont bafoués. En effet, nombre de pays en développement qui étaient auto-suffisants en produits alimentaires (comme Haïti avec le riz) au début des années 1980 importent aujourd’hui les denrées nécessaires à leur population. Alors que les gouvernements recouraient fréquemment à des subventions pour maintenir les denrées de base à un prix abordable pour les plus démunis, le FMI et la Banque mondiale ont exigé la suppression de toutes ces aides, ce qui a pour conséquence l’augmentation du prix de ces aliments mais aussi du combustible. Les populations rencontrent alors d’énormes difficultés pour subvenir à leurs besoins alimentaires, pour la cuisson des aliments, pour faire bouillir l’eau et la rendre potable. Le prix des transports augmente lui aussi, ne laissant pas d’autre choix aux petits paysans que de répercuter cette hausse sur le prix de leurs productions vendues en ville. Les populations, soumises à rude épreuve, réagissent. Des « émeutes anti-FMI », ou « émeutes de la faim », éclatent à intervalles réguliers au Sud. Citons l’exemple du Pérou en 1991 où le prix du pain est multiplié par 12 en une nuit, ou celui du Caracazo (trois jours d’émeutes occasionnant de nombreux morts) au Venezuela en 1989, ou encore plus récemment l’impact de la dégradation des conditions de vie en Tunisie, en Égypte et dans tout le monde arabe, qui a produit d’énormes convulsions sociales entraînant notamment la chute des présidents Ben Ali et Moubarak, en janvier et février 2011 respectivement.
Au Nord, on peut citer les cas éclairants de la Hongrie et de la Lettonie qui ont eu recours, parmi les premiers au sein de l’Union européenne, aux prêts du FMI. Les conditionnalités qui accompagnent ces prêts sont de véritables purges sociales, autant d’attaques contre les acquis sociaux et contre les travailleurs-euses, chômeurs-euses, précaires, que le FMI et l’Union européenne, main dans la main avec les marchés financiers, entendent généraliser à l’ensemble des pays européens. Le plan d’ « aide » à la Hongrie, d’un montant de 20 milliards d’euros, est décidé en octobre 2008 (12,3 milliards d’euros prêtés par le FMI, 6,5 par l’Union européenne et 1 par la Banque mondiale). Outre l’accroissement mécanique du stock de la dette et la perte sèche en paiement des intérêts, les conditions sont sévères pour la population : hausse de 5 points de la TVA, aujourd’hui à 25% ; âge légal de départ à la retraite porté à 65 ans ; gel des salaires des fonctionnaires pour deux ans ; suppression du treizième mois des retraités. L’accord signé en juin 2009 avec la Lettonie s’inscrit dans la même veine en conditionnant l’octroi d’un prêt du FMI de 7,5 milliards de dollars à une baisse de 15 % du salaire des fonctionnaires, à une diminution du salaire minimum et à une baisse du montant des retraites.
Il existe donc un lien direct entre la violation caractérisée des DESC et les plans d’austérité appliqués par les gouvernements du Sud et du Nord sous la pression de leurs créanciers.
En somme, en s’engageant dans des politiques de rigueur telles que définies par le FMI, les États débiteurs sacrifient les droits humains. Ils doivent donc au minimum réaliser un audit de la dette, refuser d’appliquer des mesures qui violent les DESC et, le cas échéant, suspendre le paiement de la dette pendant la durée de l’audit. À l’issue des travaux de l’audit, les États doivent refuser la poursuite du remboursement des dettes illégitimes.
Soulignons que les États n’ont pas seulement l’obligation de respecter les droits humains : ils doivent également les protéger et les promouvoir. À ce titre, ils ont le devoir d’empêcher les tiers de porter atteinte aux droits de leurs populations, ce qui implique de réformer radicalement, d’abolir ou de se retirer d’institutions telles que le FMI, la Banque mondiale, l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui sont au service des sociétés transnationales, au détriment de la puissance publique et des besoins fondamentaux de la population.
En effet, en 2000, l’expert indépendant des Nations unies sur la dette extérieure Fantu Cheru soulignait que les plans d’ajustement structurel imposés par ces institutions vont au-delà « de la simple imposition d’un ensemble de mesures macroéconomiques au niveau interne. Elles [sont] l’expression d’un projet politique, d’une stratégie délibérée de transformation sociale à l’échelle mondiale, dont l’objectif principal est de faire de la planète un champ d’action où les sociétés transnationales pourront opérer en toute sécurité. Bref, les programmes d’ajustement structurel (PAS) jouent un rôle de ‘courroie de transmission’ pour faciliter le processus de mondialisation qui passe par la libéralisation, la déréglementation et la réduction du rôle de l’État dans le développement national |10| ».
Quels textes juridiques invoquer ?
Les différentes conventions internationales citées plus haut donnent aux États des armes juridiques pour suspendre le remboursement de la dette et pour mener des politiques de développement autonomes visant la satisfaction des besoins humains fondamentaux. Dans un esprit de synthèse, nous voulons esquisser certaines dispositions juridiques contenues dans les textes précités pouvant fonder la suspension unilatérale du paiement de la dette (qui, le cas échéant, peut aller jusqu’à la nullité de la dette) et le refus des conditionnalités imposées par les créanciers.
a) Article 103 de la Charte des Nations unies
Cet article indique : « En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. » Cette disposition, qui pose clairement la suprématie de la Charte sur tout autre engagement, justifie à la fois un moratoire sur la dette publique (avec gel des intérêts), la non-application des programmes d’austérité et même la nullité pure et simple des dettes et des accords contrevenant aux principes inscrits dans la Charte, comme l’objectif de relèvement des niveaux de vie des populations. En effet, les dispositions de la Charte ayant une valeur législative d’ordre public, tout ce qui y est contraire doit être réputé non écrit |11|. Par conséquent, les mesures antisociales imposées par les créanciers, qui hypothèquent la souveraineté des États, devraient être frappées de nullité.
b) Article 1 des deux Pactes internationaux de 1966 sur les droits humains
Selon l’article 1 commun aux deux Pactes : « Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. »
Il est clair que les plans d’ajustement structurel, rebaptisés Documents ou Cadres stratégiques de croissance et de réduction de la pauvreté par le FMI et la Banque mondiale depuis la fin des années 1990, violent l’article premier commun aux deux Pactes de 1966. Comme le soulignait en 2009 Cephas Lumina, expert indépendant de l’ONU sur la dette extérieure des PED, les Parlements nationaux au Sud ne sont pas consultés dans la plupart des cas et l’adoption finale de ces documents est toujours conditionnée par l’accord final des IFI.
En Europe, les diktats des marchés financiers, de la Commission européenne et du FMI nient également le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
c) L’article 28 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) de 1948
Dans cet article, la DUDH affirme que « toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet ». Cela suppose l’élimination de systèmes et de structures injustes comme une condition de la réalisation des droits humains et libertés fondamentales |12|.
Cette affirmation est également présente dans la Déclaration sur le droit au développement adoptée le 4 décembre 1986 par l’Assemblée générale des Nations unies. L’article 3 de cette déclaration énonce que : « Les États ont le devoir de coopérer les uns avec les autres pour assurer le développement et éliminer les obstacles au développement ». Comme nous l’avons vu plus haut avec les exemples de violations de DESC au Sud et au Nord, l’application des conditionnalités imposées par les créanciers constitue un obstacle au respect des droits humains fondamentaux. Les États doivent donc les refuser. Ils ont également intérêt à suspendre le paiement de la dette qui accapare des ressources vitales pour le développement des peuples. À titre d’exemple, le remboursement du service de la dette accapare 35% du budget de l’État jamaïcain, soit trois fois plus que les dépenses de santé et d’éducation cumulées. En France, le service de la dette représente trois fois le budget de l’enseignement scolaire et huit fois le budget de la justice.
d) Article 2 de la Déclaration de l’ONU sur le droit au développement (1986)
Selon l’article 2 alinéa 3 : « Les États ont le droit et le devoir de formuler des politiques de développement national appropriées ayant pour but l’amélioration constante du bien-être de l’ensemble de la population et de tous les individus sur la base de leur participation active, libre et significative dans le développement et la distribution équitables des bénéfices issus de celui-ci ». Étant incompatible avec les plans d’austérité d’inspiration néolibérale, cette obligation impose aux États de mettre fin aux conditionnalités imposées par le FMI, la Banque mondiale et la Commission européenne.
e) La force majeure : à l’impossible nul n’est tenu
Les trois notions suivantes (force majeure, état de nécessité, changement fondamental de circonstance) sont inscrites dans la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, ainsi que dans de nombreuses législations nationales, principalement en matière de contrat. Ces normes juridiques font également partie du droit coutumier international et, en tant que telles, elles s’imposent à tous les débiteurs et créanciers, sans qu’il soit nécessaire de prouver leur consentement à y être liés et l’illégalité de la dette.
La Commission du droit international de l’ONU définit la force majeure ainsi : « L’impossibilité d’agir légalement [...] est la situation dans laquelle un événement imprévu et extérieur à la volonté de celui qui l’invoque, le met dans l’incapacité absolue de respecter son obligation internationale en vertu du principe selon lequel à l’impossible nul n’est tenu |13| ».
Le Comité préparatoire de la Conférence pour la codification (La Haye, 1930) admet l’applicabilité de l’argument de la force majeure à la dette car, selon ce Comité, « la responsabilité de l’État se trouve engagée si, par une disposition législative [...] il en suspend ou modifie le service total ou partiel [de la dette], à moins d’y être contraint par des nécessités financières |14| ».
La jurisprudence internationale reconnaît également de manière explicite cet argument, qui légitime la suspension du paiement de la dette à l’égard des créanciers publics (États, FMI, Banque mondiale…) et privés. Entre autres cas, citons la sentence arbitrale du 11 novembre 1912 prononcée par la Cour permanente d’arbitrage de La Haye dans l’« Affaire des indemnités russes » |15|. Entre 1889 et 1912, la Turquie a traversé une grave crise financière qui l’a rendue incapable d’honorer ses remboursements envers la Russie tsariste. La Cour permanente d’arbitrage a reconnu le bien-fondé de l’argument de force majeure présenté par le gouvernement turc. La Cour a affirmé en effet que la force majeure est opposable aussi bien en droit international public que privé et précise que « le droit international doit s’adapter aux nécessités politiques ». En effet, la force majeure se situe là où les intérêts fondamentaux de l’État sont en jeu et le respect des droits humains de sa population implique des décisions politiques fortes, comme le moratoire sur la dette avec gel des intérêts.
Bien qu’en principe la force majeure ait un caractère temporaire, si la cause qui l’a provoquée se prolonge dans le temps, l’exécution de l’obligation financière devient alors définitivement impossible. Par conséquent, la suspension pourrait se traduire ensuite par une annulation pure et simple de la dette. Mentionnons ici le décret du Gouvernement soviétique du 28 janvier 1918, par lequel la République socialiste décide que « tous les prêts étrangers sont annulés inconditionnellement et sans aucune exception ». Pour prendre cet acte unilatéral célèbre, le gouvernement russe s’est notamment fondé sur la force majeure.
f) L’état de nécessité
L’état de nécessité correspond à une situation de « danger pour l’existence de l’État, pour sa survie politique ou sa survie économique » |16|. Pour la Commission du droit international de l’ONU, cet argument peut être invoqué lorsque « ce fait aura été l’unique moyen de sauvegarder l’intérêt essentiel de l’État à l’encontre d’un danger grave et imminent » |17|.
La survie économique se réfère directement aux ressources dont un État peut disposer pour continuer à satisfaire les besoins de la population, en matière de santé, d’éducation, de sécurité publique (comme maintenir un bon fonctionnement des services de luttes contre l’incendie et de protection civile)…, ce qui nous renvoie à la part du budget des États consacrée au service de la dette, en comparaison avec celle destinée aux besoins des populations. Dès lors, la suspension immédiate du paiement de la dette (avec gel des intérêts) ainsi que le refus des conditionnalités s’imposent, dans de très nombreux cas, comme « l’unique moyen de sauvegarder l’intérêt essentiel de l’État ». En effet, en droit international, un des éléments fondamentaux de l’État est sa population |18|. L’État a des obligations vis-à-vis de ses nationaux et des étrangers qui se trouvent sous sa juridiction. La première de ces obligations est de respecter leurs droits humains fondamentaux.
À la différence de la force majeure, l’état de nécessité ne met pas l’État en situation matérielle d’empêchement absolu de remplir ses obligations internationales. Mais le fait de les exécuter impliquerait pour la population des sacrifices qui vont au-delà de ce qui est raisonnable. En effet, comme le souligne la Commission du droit international : « On ne peut attendre d’un État qu’il ferme ses écoles et ses universités et ses tribunaux, qu’il abandonne les services publics de telle sorte qu’il livre sa communauté au chaos et à l’anarchie simplement pour ainsi disposer de l’argent pour rembourser ses créanciers étrangers ou nationaux. Il y a des limites à ce qu’on peut raisonnablement attendre d’un État, de la même façon que pour un individu... |19| ».
Tout comme la force majeure, l’état de nécessité peut fonder la suspension et la répudiation/annulation |20| (si l’état de nécessité se prolonge) de dettes contractées vis-à-vis d’autres États, d’organisations internationales et d’entités privées |21|. Dans l’affaire des « forêts du Rhodope central » |22|, la Bulgarie devait payer à la Grèce des réparations. Devant le Conseil de la Société des Nations, la Bulgarie a évoqué l’état de nécessité, fondé sur les graves conséquences financières que ce paiement aurait occasionnées à l’État et à l’économie du pays. Les deux gouvernements ont notamment reconnu que l’état de nécessité pouvait servir de base juridique pour répudier une dette publique. Ainsi, lorsqu’on parle d’état de nécessité dans le contexte de paiement d’une dette, il est évident que c’est la fonction publique même de l’État qui est menacée.
g) Le changement fondamental de circonstances
Cette norme juridique, qui se matérialise dans la clause rebus sic stantibus (les choses doivent demeurer en l’état - le même état qu’au moment de la signature du contrat), a pour conséquence de délier les parties de toute obligation contenue dans le contrat en cas de changement profond des circonstances. Elle fonde ainsi le droit pour un État de mettre un terme à l’application d’un traité international ou d’un contrat de manière transitoire ou définitive.
Appliquée à la dette, la clause rebus sic stantibus fonde le droit pour un État de suspendre ou de répudier unilatéralement les dettes affectées par ce changement fondamental de circonstances si deux conditions sont réunies : ![]() le changement de circonstances doit présenter un caractère d’une certaine importance. Dans son arrêt Compétence en matière de pêcheries |23|, la Cour internationale de justice fait observer que le caractère fondamental du changement doit s’apprécier comme entraînant une transformation radicale de la portée des obligations, les rendant « plus lourdes » à supporter pour l’une des parties |24| ;
le changement de circonstances doit présenter un caractère d’une certaine importance. Dans son arrêt Compétence en matière de pêcheries |23|, la Cour internationale de justice fait observer que le caractère fondamental du changement doit s’apprécier comme entraînant une transformation radicale de la portée des obligations, les rendant « plus lourdes » à supporter pour l’une des parties |24| ; ![]() ce changement doit porter sur des circonstances ayant constitué, selon l’expression formulée par l’article 62 de la Convention de Vienne de 1969, « une base essentielle du consentement des parties à être liées par le traité ».
ce changement doit porter sur des circonstances ayant constitué, selon l’expression formulée par l’article 62 de la Convention de Vienne de 1969, « une base essentielle du consentement des parties à être liées par le traité ».
S’agissant de la dette des pays en développement, il ne fait aucun doute que la décision des États-Unis en 1979 de relever unilatéralement les taux d’intérêt constitue un changement fondamental de circonstances. Primo, ce changement est important car les pays du Sud ont dû rembourser en quelques semaines trois fois plus d’intérêts qu’auparavant. Ce qui a contribué à les plonger, quelques années plus tard, dans une crise sans précédent, entraînant la dégradation des conditions de vie de millions d’êtres humains et le renforcement de la soumission de ces États au diktat des institutions financières internationales. Secundo, ce changement a porté sur une base essentielle du consentement des parties à conclure des prêts. En effet, le recours à l’endettement était fortement incité par les faibles taux d’intérêt de l’époque (les taux réels étaient même négatifs au milieu des années 1970 car inférieurs à l’inflation) et par l’imposition d’un modèle de « développement » prônant l’absolue nécessité de capitaux extérieurs, directement inspiré de la fameuse théorie de Rostow sur le décollage économique, qui n’a toujours pas été validée par les faits |25| mais dont la Banque mondiale demeure l’apôtre.
Par conséquent, tous les gouvernements du Sud affectés par la crise de la dette du tiers-monde sont au minimum fondés à suspendre le paiement des intérêts qui se sont accumulés suite à l’éclatement de la crise. Ils pourraient également, sur la base de cet argument juridique du changement fondamental de circonstances, répudier ces intérêts et même réclamer la restitution des sommes indûment perçues par les créanciers, vu que leur enrichissement n’a pas de fondement légal. Il s’agit, en effet, d’un enrichissement sans cause.
Bien des auteurs, dont Joseph Stiglitz, prix d’économie de la Banque centrale de Suède en mémoire d’Alfred Nobel (2001) |26| et ancien économiste en chef de la Banque mondiale (de 1997 à 2000), confirment que la décision unilatérale de la Réserve fédérale des États-Unis a provoqué un « changement fondamental de circonstances ».
Henry Kissinger, ex-secrétaire d’État du gouvernement états-unien, précise les conséquences économiques et sociales de la crise de la dette : « Il s’agit évidemment d’un problème de solvabilité : certains pays doivent plus que ce qu’ils sont en mesure de rembourser. Les programmes d’ajustement temporaires de 1982 se sont convertis en austérité apparemment permanente en 1988. Depuis 1982, l’Amérique latine a payé près de 235 000 millions de dollars en intérêts, mais son endettement a été augmenté de 50 000 millions de dollars. L’Amérique latine, une région sous-développée, s’est transformée en exportateur net de capitaux, ce qui constitue une situation indéfendable et injuste [...]. Aucun gouvernement démocratique ne peut supporter l’austérité prolongée et les compressions budgétaires des services sociaux exigées par les institutions internationales |27| ».
À la lumière de l’actualité récente, la Grèce, l’Irlande, le Portugal (et la liste s’allongera probablement) se retrouvent dans une situation similaire : suite à l’éclatement de la crise des subprime aux États-Unis en 2007, dont l’onde de choc en Europe y a provoqué des crises bancaires et une récession sévère, ces pays sont confrontés à des hausses des taux d’intérêt exigés par les investissseurs institutionnels (les « zinzins ») qui dominent les marchés financiers. Les taux qui s’appliquent à ces pays en 2010-2011 ont doublé par rapport à 2008-2009 alors que, dans le même temps, les taux directeurs des banques centrales ont baissé. En 2010, l’Irlande devait rémunérer les détenteurs de sa dette souveraine (titres à 10 ans) au taux élevé de 9,3 % (contre 2,7 % pour l’Allemagne), charge excessive qui l’a amenée à emprunter à cours terme et à mettre en œuvre une politique de rigueur brutale. Le pays est maintenant au bord du gouffre avec une croissance proche de zéro et un taux de chômage s’élevant à 13 %. La Grèce quant à elle devait promettre 11,9 % de taux d’intérêt pour emprunter sur une durée de 10 ans, ce qui l’a obligée à emprunter à court terme comme l’Irlande et à porter des atteintes très graves aux DESC de sa population. Si les zinzins demandent des intérêts majorés, c’est qu’ils anticipent des défauts de paiement et/ou des annulations de dettes. Une suspension du remboursement de la dette (avec gel des intérêts) décidée unilatéralement par ces pays fait donc partie des risques pris en toute conscience par les créanciers. Elle fait pleinement partie des règles du jeu et serait justifiée. Les pays s’engageant dans cette voie auraient tout intérêt à utiliser l’argument juridique du changement fondamental de circonstances, lié à cette augmentation brutale des taux d’intérêts imposée par les marchés financiers qui, circonstance aggravante, empruntent à seulement 1% à la Banque centrale européenne ou à 3% aux épargnants.
Finalement, compte tenu du poids de la dette et de l’aggravation des conditions de vie des populations sous l’effet des mesures d’austérité, les pouvoirs publics au Nord et au Sud disposent de nombreux arguments juridiques pour suspendre immédiatement le remboursement de leurs dettes (avec gel des intérêts) et refuser l’application des aspects des plans d’austérité qui portent atteinte aux droits économiques, sociaux et culturels.
Parallèlement à cette suspension de paiement, les États doivent sans tarder mener des audits de leur dette, avec participation citoyenne, afin de déterminer toutes les dettes illégitimes, en prenant exemple sur la démarche récente de l’Équateur |28|.
Quelques fondements juridiques pour déclarer la nullité des dettes publiques
De nombreux arguments juridiques existent pour fonder en droit une suspension des remboursements des dettes publiques, pouvant conduire à leur annulation pure et simple. Pour juger de la nullité d’un contrat de prêt, il faut non seulement prêter attention aux clauses du contrat, mais également aux circonstances entourant la conclusion du contrat et à la destination réelle des fonds empruntés |29|. À coup sûr, un audit de la dette sera nécessaire pour mettre en lumière ces différents éléments. Les États qui veulent agir sur la dette peuvent se saisir d’arguments issus du droit international public, dont ceux que nous mettons en évidence ci-dessous, pour fonder l’annulation/répudiation de certaines dettes publiques |30|.
Les vices du consentement
La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et la Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales de 1986 indiquent les différents vices du consentement pouvant entraîner la nullité du contrat de prêt. Parmi eux, on trouve :
![]() l’incompétence du contractant |31|. À titre d’exemple, ce vice du consentement a constitué un motif juridique de la répudiation par le Paraguay d’une dette s’élevant à 85 millions de dollars en 2005. En effet, le Consul du Paraguay à Genève qui avait signé au nom de l’État n’avait aucun pouvoir légal pour contracter ce prêt envers la banque privée Overland Trust Bank |32| ;
l’incompétence du contractant |31|. À titre d’exemple, ce vice du consentement a constitué un motif juridique de la répudiation par le Paraguay d’une dette s’élevant à 85 millions de dollars en 2005. En effet, le Consul du Paraguay à Genève qui avait signé au nom de l’État n’avait aucun pouvoir légal pour contracter ce prêt envers la banque privée Overland Trust Bank |32| ;
![]() la corruption du contractant par des moyens directs ou indirects lors de la négociation |33|. On peut citer l’exemple des contrats passés entre la Grèce et la transnationale Siemens, accusée - tant par la justice allemande que grecque - d’avoir versé des commissions et autres pots de vin au personnel politique, militaire et administratif grec pour un montant approchant le milliard d’euros ;
la corruption du contractant par des moyens directs ou indirects lors de la négociation |33|. On peut citer l’exemple des contrats passés entre la Grèce et la transnationale Siemens, accusée - tant par la justice allemande que grecque - d’avoir versé des commissions et autres pots de vin au personnel politique, militaire et administratif grec pour un montant approchant le milliard d’euros ;
![]() la contrainte |34| exercée sur le contractant au moyen d’actes ou de menaces dirigés contre lui. À titre d’exemple, la contrainte a été utilisée en 1824 par les Français pour imposer à Haïti le paiement d’une rançon colossale |35| en échange de la reconnaissance de son indépendance. Dans ce but, treize bateaux français équipés de 494 canons entourèrent l’île d’Haïti et la consigne était claire : en cas de refus, les ports devaient être bloqués par la force. La contrainte pose également la question du rapport de force politique très favorable au créancier. En effet, lorsqu’il y a un déséquilibre entre les parties, le débiteur ne bénéficie pas de liberté pour contracter et le créancier a la possibilité de s’imposer unilatéralement. C’est ainsi qu’en 2010, le gouvernement grec a été mis sous pression par les autorités françaises et allemandes qui voulaient garantir leurs exportations d’armes. Le lobby militaro-industriel a réussi à obtenir que le budget de la Défense soit à peine écorné alors que dans le même temps, le gouvernement du PASOK a entrepris de tailler dans les dépenses sociales ;
la contrainte |34| exercée sur le contractant au moyen d’actes ou de menaces dirigés contre lui. À titre d’exemple, la contrainte a été utilisée en 1824 par les Français pour imposer à Haïti le paiement d’une rançon colossale |35| en échange de la reconnaissance de son indépendance. Dans ce but, treize bateaux français équipés de 494 canons entourèrent l’île d’Haïti et la consigne était claire : en cas de refus, les ports devaient être bloqués par la force. La contrainte pose également la question du rapport de force politique très favorable au créancier. En effet, lorsqu’il y a un déséquilibre entre les parties, le débiteur ne bénéficie pas de liberté pour contracter et le créancier a la possibilité de s’imposer unilatéralement. C’est ainsi qu’en 2010, le gouvernement grec a été mis sous pression par les autorités françaises et allemandes qui voulaient garantir leurs exportations d’armes. Le lobby militaro-industriel a réussi à obtenir que le budget de la Défense soit à peine écorné alors que dans le même temps, le gouvernement du PASOK a entrepris de tailler dans les dépenses sociales ;
![]() le dol |36|. Si un État a été amené à conclure le prêt par la conduite frauduleuse d’un autre État ou d’une organisation internationale ayant participé à la négociation, il peut invoquer le dol comme viciant son consentement à être lié par ledit contrat. On peut ainsi qualifier de dolosif le comportement du FMI et de la Banque mondiale, tant le fossé entre leurs discours et la réalité est abyssal. En effet, dans l’article 1 de ses statuts, le FMI a pour objectifs de « faciliter l’expansion et l’accroissement harmonieux du commerce international et contribuer ainsi à l’instauration et au maintien de niveaux élevés d’emploi et de revenu réel et au développement des ressources productives de tous les États membres, objectifs premiers de la politique économique |37| ». Or, dans les faits, cette institution, en coordination avec la Banque mondiale, fait tout le contraire et viole donc ses propres statuts |38| . Le chômage augmente régulièrement en conséquence de l’application des mesures induites par le FMI et/ou la Banque mondiale. On constate également souvent une chute des revenus des salariés, des petits producteurs et des classes moyennes. Sans oublier un creusement des inégalités dans la plupart des pays où ces institutions sont intervenues.
le dol |36|. Si un État a été amené à conclure le prêt par la conduite frauduleuse d’un autre État ou d’une organisation internationale ayant participé à la négociation, il peut invoquer le dol comme viciant son consentement à être lié par ledit contrat. On peut ainsi qualifier de dolosif le comportement du FMI et de la Banque mondiale, tant le fossé entre leurs discours et la réalité est abyssal. En effet, dans l’article 1 de ses statuts, le FMI a pour objectifs de « faciliter l’expansion et l’accroissement harmonieux du commerce international et contribuer ainsi à l’instauration et au maintien de niveaux élevés d’emploi et de revenu réel et au développement des ressources productives de tous les États membres, objectifs premiers de la politique économique |37| ». Or, dans les faits, cette institution, en coordination avec la Banque mondiale, fait tout le contraire et viole donc ses propres statuts |38| . Le chômage augmente régulièrement en conséquence de l’application des mesures induites par le FMI et/ou la Banque mondiale. On constate également souvent une chute des revenus des salariés, des petits producteurs et des classes moyennes. Sans oublier un creusement des inégalités dans la plupart des pays où ces institutions sont intervenues.
La cause illicite ou immorale du contrat
Ce fondement juridique se retrouve dans de nombreuses législations nationales civiles et commerciales. Parmi les causes illicites ou immorales entraînant l’illégalité du contrat de prêt, on trouve entre autres :
![]() l’achat de matériel militaire. L’article 26 de la Charte de l’ONU de 1945 impose aux États de réglementer le commerce des armements et de n’affecter que le minimum de leurs ressources au domaine militaire. Or, les dépenses militaires augmentent d’année en année au niveau mondial, en violation de la Charte de l’ONU ;
l’achat de matériel militaire. L’article 26 de la Charte de l’ONU de 1945 impose aux États de réglementer le commerce des armements et de n’affecter que le minimum de leurs ressources au domaine militaire. Or, les dépenses militaires augmentent d’année en année au niveau mondial, en violation de la Charte de l’ONU ;
![]() l’aide liée. Face à la récession généralisée et au chômage massif dans les années 1970, les pays riches ont décidé de distribuer du pouvoir d’achat aux pays du Sud, afin de les inciter à acheter les marchandises produites par le Nord, en leur accordant des prêts d’État à État, souvent sous forme de crédits d’exportations : c’est l’aide liée. Composée notamment de prêts, elle se traduit pour le pays « bénéficiaire » à la fois par un surcoût notable des services ou biens achetés et par une augmentation de sa dette. Selon une étude de la Banque mondiale, sur la période 1962-1987, les pays africains ont payé leurs importations de produits sidérurgiques plus chers que les pays industrialisés (jusqu’à 23% dans le cas des importations provenant de France |39| ). Cette pratique est d’autant plus illégitime que le plus souvent, ces prêts liés ne correspondent pas aux besoins réels du pays mais aux intérêts du « donateur ». C’est ce qui a conduit la Norvège en 2006 à annuler unilatéralement et sans conditions des dettes de cinq pays : Équateur, Égypte, Jamaïque, Pérou et Sierra Leone |40| ;
l’aide liée. Face à la récession généralisée et au chômage massif dans les années 1970, les pays riches ont décidé de distribuer du pouvoir d’achat aux pays du Sud, afin de les inciter à acheter les marchandises produites par le Nord, en leur accordant des prêts d’État à État, souvent sous forme de crédits d’exportations : c’est l’aide liée. Composée notamment de prêts, elle se traduit pour le pays « bénéficiaire » à la fois par un surcoût notable des services ou biens achetés et par une augmentation de sa dette. Selon une étude de la Banque mondiale, sur la période 1962-1987, les pays africains ont payé leurs importations de produits sidérurgiques plus chers que les pays industrialisés (jusqu’à 23% dans le cas des importations provenant de France |39| ). Cette pratique est d’autant plus illégitime que le plus souvent, ces prêts liés ne correspondent pas aux besoins réels du pays mais aux intérêts du « donateur ». C’est ce qui a conduit la Norvège en 2006 à annuler unilatéralement et sans conditions des dettes de cinq pays : Équateur, Égypte, Jamaïque, Pérou et Sierra Leone |40| ;
| L’exemple de la Norvège
Le 2 octobre 2006, au cours d’une conférence de presse donnée à Oslo, le ministre norvégien du Développement international, Erik Solheim, annonce l’annulation unilatérale et sans condition des dettes des cinq pays suivants : Équateur, Égypte, Jamaïque, Pérou et Sierra Leone, reconnaissant de fait la part de responsabilité de la Norvège dans leur endettement illégitime. Ces annulations représentent un montant d’environ 80 millions de dollars |41|. Cette décision est motivée par le fait que le projet de développement sur lequel se fondaient les demandes de remboursement de la Norvège, à savoir la campagne d’exportation de navires qui avait eu lieu à la fin des années 1970, s’était avéré être un échec : « Cette campagne représente un véritable fiasco de nos politiques de développement. En tant que pays créancier, la Norvège a sa part de responsabilité dans les dettes qui s’en sont suivies. En renonçant à ces créances, la Norvège reconnaît sa responsabilité et permet à ces cinq pays de mettre un terme définitif aux paiements restants de leurs dettes |42| ». Pour la première fois dans l’histoire, un pays prêteur du Nord admet être responsable de politiques de prêt inadéquates et prend les mesures qui s’imposent. Cette décision vient rompre avec le consensus tacite aujourd’hui en vigueur au sein du Club de Paris. La démarche de la Norvège représente donc un pas en avant décisif vers la reconnaissance de la responsabilité des prêteurs dans le processus d’endettement légitime |43|. |
![]() des financements conditionnés à l’ajustement structurel. Comme l’affirme le rapporteur spécial Mohammed Bedjaoui dans son projet d’article sur la succession en matière de dettes d’État pour la Convention de Vienne de 1983 : « En se plaçant du point de vue de la communauté internationale, on pourrait entendre par dette odieuse toute dette contractée pour des buts non conformes au droit international contemporain, et plus particulièrement aux principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies |44| ». Ainsi, les dettes multilatérales contractées dans le cadre d’ajustements structurels sont des dettes odieuses, donc illicites, tant le caractère préjudiciable de ces politiques a été clairement démontré, notamment par des organes de l’ONU. Les conditionnalités liées à ces dettes violent de façon manifeste les différents textes de protection des droits humains. L’abandon de la souveraineté des États est encore aggravée par les clauses contenues dans la plupart des contrats de prêts internationaux prévoyant la compétence des juridictions situées au Nord et l’application de règles favorisant les créanciers en cas de litige entre les parties. En Équateur, la Commission d’audit intégral du crédit public (CAIC) a mis en évidence que l’imposition de politiques par la Banque mondiale et d’autres institutions multilatérales, à travers les programmes qu’elles ont financés et les conditionnalités attachées aux prêts, constitue un déni de souveraineté et une ingérence flagrante dans les affaires internes de l’État. Nombre de prêts multilatéraux ont également violé les droits économiques, sociaux et culturels. Dans ses recommandations, la CAIC propose de mettre fin au paiement de plusieurs créances réclamées par les institutions multilatérales |45| ;
des financements conditionnés à l’ajustement structurel. Comme l’affirme le rapporteur spécial Mohammed Bedjaoui dans son projet d’article sur la succession en matière de dettes d’État pour la Convention de Vienne de 1983 : « En se plaçant du point de vue de la communauté internationale, on pourrait entendre par dette odieuse toute dette contractée pour des buts non conformes au droit international contemporain, et plus particulièrement aux principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies |44| ». Ainsi, les dettes multilatérales contractées dans le cadre d’ajustements structurels sont des dettes odieuses, donc illicites, tant le caractère préjudiciable de ces politiques a été clairement démontré, notamment par des organes de l’ONU. Les conditionnalités liées à ces dettes violent de façon manifeste les différents textes de protection des droits humains. L’abandon de la souveraineté des États est encore aggravée par les clauses contenues dans la plupart des contrats de prêts internationaux prévoyant la compétence des juridictions situées au Nord et l’application de règles favorisant les créanciers en cas de litige entre les parties. En Équateur, la Commission d’audit intégral du crédit public (CAIC) a mis en évidence que l’imposition de politiques par la Banque mondiale et d’autres institutions multilatérales, à travers les programmes qu’elles ont financés et les conditionnalités attachées aux prêts, constitue un déni de souveraineté et une ingérence flagrante dans les affaires internes de l’État. Nombre de prêts multilatéraux ont également violé les droits économiques, sociaux et culturels. Dans ses recommandations, la CAIC propose de mettre fin au paiement de plusieurs créances réclamées par les institutions multilatérales |45| ;
![]() la construction de projets non rentables ou qui portent préjudice aux populations et à l’environnement. Parmi ces projets, on trouve les « éléphants blancs », comme le barrage d’Inga en RDC (ex-Zaïre) qui n’a aucunement bénéficié à la population : encore aujourd’hui, moins de 10% de la population congolaise a accès à l’électricité. Les exemples de projets générateurs de dettes sont légion au Nord également. On peut citer à titre d’exemple le scandale des Jeux olympiques de 2004 en Grèce. Alors que les autorités helléniques prévoyaient une dépense de 1,3 milliard de dollars, le coût de ces jeux a dépassé en réalité les 20 milliards de dollars ;
la construction de projets non rentables ou qui portent préjudice aux populations et à l’environnement. Parmi ces projets, on trouve les « éléphants blancs », comme le barrage d’Inga en RDC (ex-Zaïre) qui n’a aucunement bénéficié à la population : encore aujourd’hui, moins de 10% de la population congolaise a accès à l’électricité. Les exemples de projets générateurs de dettes sont légion au Nord également. On peut citer à titre d’exemple le scandale des Jeux olympiques de 2004 en Grèce. Alors que les autorités helléniques prévoyaient une dépense de 1,3 milliard de dollars, le coût de ces jeux a dépassé en réalité les 20 milliards de dollars ;
![]() la dette privée transformée en dette publique. Les crises financières qui ont éclaté dans les années 1990 dans le sud-est asiatique, en Équateur, en Argentine, au Brésil et en Russie trouvent leur origine dans l’application des mesures prônées par la Banque mondiale et le FMI, qui imposent notamment la dérèglementation du système financier et l’interdiction du contrôle par les États des mouvements des capitaux. Résultat : les capitaux étrangers ont fui ces pays dès que les perspectives de profits se sont assombries, entraînant des faillites bancaires en chaîne. Les dettes de ces banques privées sont ensuite devenues les dettes publiques des États, sous l’impulsion des responsables de ces crises : la Banque mondiale et le FMI. La crise mondiale, qui a éclaté en 2007, a encore aggravé la situation des finances publiques et accru le niveau de la dette publique (principalement au Nord), du fait de l’intervention des gouvernements du Nord pour sauver les banques en faillite. La cause de cet endettement public au Sud et au Nord (lié à la nationalisation des dettes du secteur financier) est au minimum immorale, puisque les responsables directs de ces crises sont les institutions financières internationales et les banques privées. L’augmentation vertigineuse de cette dette publique constitue également le résultat des politiques néolibérales appliquées pendant les années 1980-90, qui avaient comme caractéristique essentielle la diminution des impôts des riches et des grandes entreprises. Les recettes de l’État étaient devenues insuffisantes, d’où le recours à l’endettement public pour financer les dépenses de l’État. En Équateur, la CAIC a condamné le transfert à l’État des dettes privées, réalisé en 1983 et 1984 sous la pression du FMI et de la Banque mondiale alors que le pays traversait une grave crise financière. Suite à la mise en évidence de cette opération extrêmement préjudiciable pour le pays, la nouvelle Constitution de l’Équateur adoptée en septembre 2008 interdit expressément l’étatisation des dettes privées |46| ;
la dette privée transformée en dette publique. Les crises financières qui ont éclaté dans les années 1990 dans le sud-est asiatique, en Équateur, en Argentine, au Brésil et en Russie trouvent leur origine dans l’application des mesures prônées par la Banque mondiale et le FMI, qui imposent notamment la dérèglementation du système financier et l’interdiction du contrôle par les États des mouvements des capitaux. Résultat : les capitaux étrangers ont fui ces pays dès que les perspectives de profits se sont assombries, entraînant des faillites bancaires en chaîne. Les dettes de ces banques privées sont ensuite devenues les dettes publiques des États, sous l’impulsion des responsables de ces crises : la Banque mondiale et le FMI. La crise mondiale, qui a éclaté en 2007, a encore aggravé la situation des finances publiques et accru le niveau de la dette publique (principalement au Nord), du fait de l’intervention des gouvernements du Nord pour sauver les banques en faillite. La cause de cet endettement public au Sud et au Nord (lié à la nationalisation des dettes du secteur financier) est au minimum immorale, puisque les responsables directs de ces crises sont les institutions financières internationales et les banques privées. L’augmentation vertigineuse de cette dette publique constitue également le résultat des politiques néolibérales appliquées pendant les années 1980-90, qui avaient comme caractéristique essentielle la diminution des impôts des riches et des grandes entreprises. Les recettes de l’État étaient devenues insuffisantes, d’où le recours à l’endettement public pour financer les dépenses de l’État. En Équateur, la CAIC a condamné le transfert à l’État des dettes privées, réalisé en 1983 et 1984 sous la pression du FMI et de la Banque mondiale alors que le pays traversait une grave crise financière. Suite à la mise en évidence de cette opération extrêmement préjudiciable pour le pays, la nouvelle Constitution de l’Équateur adoptée en septembre 2008 interdit expressément l’étatisation des dettes privées |46| ;
![]() le remboursement d’anciens prêts illégaux. Selon l’argument juridique de la continuité du délit, une dette illicite ne perd pas, suite à un processus de renégociation ou de restructuration, son caractère illégal. En ce sens, elle conserve son vice d’origine et le délit perdure dans le temps. Par conséquent, tous les emprunts publics visant à rembourser d’anciennes dettes illégales sont eux-mêmes illicites. L’audit de la dette permettra de mettre en lumière la dette originelle illégale. Par exemple, l’argument de la continuité du délit a été utilisé par la Commission d’audit en Equateur (CAIC) pour dénoncer les nombreuses irrégularités (lors de la socialisation des dettes privées, du Plan Brady |47| et de restructurations de dettes… |48|) ayant abouti à l’émission de bons de la dette commerciale. Sur base des résultats de l’audit, les autorités équatoriennes ont alors refusé de payer cette dette commerciale envers les banques privées internationales (les bons « Global 2012 et 2030 »). En juin 2009, après une épreuve de force avec les banquiers qui détiennent ces titres de la dette équatorienne, les détenteurs de 91% des bons en question ont accepté leur rachat par l’Équateur avec une réduction de 65% de la valeur nominale ;
le remboursement d’anciens prêts illégaux. Selon l’argument juridique de la continuité du délit, une dette illicite ne perd pas, suite à un processus de renégociation ou de restructuration, son caractère illégal. En ce sens, elle conserve son vice d’origine et le délit perdure dans le temps. Par conséquent, tous les emprunts publics visant à rembourser d’anciennes dettes illégales sont eux-mêmes illicites. L’audit de la dette permettra de mettre en lumière la dette originelle illégale. Par exemple, l’argument de la continuité du délit a été utilisé par la Commission d’audit en Equateur (CAIC) pour dénoncer les nombreuses irrégularités (lors de la socialisation des dettes privées, du Plan Brady |47| et de restructurations de dettes… |48|) ayant abouti à l’émission de bons de la dette commerciale. Sur base des résultats de l’audit, les autorités équatoriennes ont alors refusé de payer cette dette commerciale envers les banques privées internationales (les bons « Global 2012 et 2030 »). En juin 2009, après une épreuve de force avec les banquiers qui détiennent ces titres de la dette équatorienne, les détenteurs de 91% des bons en question ont accepté leur rachat par l’Équateur avec une réduction de 65% de la valeur nominale ;
![]() le remboursement de dettes déjà payées. L’obligation pour un État d’honorer ses dettes est notamment limitée par les principes généraux du droit comme l’équité, la bonne foi, l’abus de droit ou encore l’enrichissement sans cause. Or, la dette des PED a déjà été remboursée plusieurs fois : d’après les données fournies par la Banque mondiale, les pouvoirs publics des PED ont déjà remboursé l’équivalent de 98 fois ce qu’ils devaient en 1970, mais entre temps leur dette a été multipliée par 32. Cela implique pour les PED le droit de répudier leur dette et de réclamer la restitution de ce qui a été indûment perçu par les créanciers, sur la base de l’enrichissement sans cause. Cette disposition est également prévue par plusieurs codes civils nationaux : le code civil argentin aux articles 784 et suivants, espagnol aux articles 1895 et suivants, français aux articles 1376 et suivants. Les PED mais aussi les pays du Nord sont pris dans une spirale infernale où ils empruntent chaque année pour pouvoir faire face aux remboursements. Cette situation est notamment la conséquence de l’augmentation brutale et unilatérale des taux d’intérêts par les États-Unis en 1979, de la pratique de taux d’intérêt usuraires ou encore de la capitalisation des intérêts (anatocisme), qui est par ailleurs interdite ou fortement réglementée dans plusieurs ordres juridiques nationaux : Équateur, France, Italie, Allemagne…
le remboursement de dettes déjà payées. L’obligation pour un État d’honorer ses dettes est notamment limitée par les principes généraux du droit comme l’équité, la bonne foi, l’abus de droit ou encore l’enrichissement sans cause. Or, la dette des PED a déjà été remboursée plusieurs fois : d’après les données fournies par la Banque mondiale, les pouvoirs publics des PED ont déjà remboursé l’équivalent de 98 fois ce qu’ils devaient en 1970, mais entre temps leur dette a été multipliée par 32. Cela implique pour les PED le droit de répudier leur dette et de réclamer la restitution de ce qui a été indûment perçu par les créanciers, sur la base de l’enrichissement sans cause. Cette disposition est également prévue par plusieurs codes civils nationaux : le code civil argentin aux articles 784 et suivants, espagnol aux articles 1895 et suivants, français aux articles 1376 et suivants. Les PED mais aussi les pays du Nord sont pris dans une spirale infernale où ils empruntent chaque année pour pouvoir faire face aux remboursements. Cette situation est notamment la conséquence de l’augmentation brutale et unilatérale des taux d’intérêts par les États-Unis en 1979, de la pratique de taux d’intérêt usuraires ou encore de la capitalisation des intérêts (anatocisme), qui est par ailleurs interdite ou fortement réglementée dans plusieurs ordres juridiques nationaux : Équateur, France, Italie, Allemagne…
L’usage illicite des fonds prêtés
La destination des fonds empruntés est un critère déterminant afin de se prononcer sur le caractère légal d’une dette. Pour cela, il faut regarder la nature du régime emprunteur, sa conduite par rapport aux droits humains ainsi que l’affectation réelle de ces fonds. Ainsi, sont frappés d’illégalité :
![]() la dette issue d’une colonisation. Au cours des années 1950 et 1960, la Banque mondiale a accordé plusieurs prêts aux métropoles coloniales dont la Belgique, la France, le Portugal et la Grande-Bretagne, pour des projets leur permettant de maximiser l’exploitation de leurs colonies. Ces dettes des puissances coloniales à l’égard de la Banque mondiale ont ensuite été transférées, pour la plupart, aux ex-pays colonisés au moment de leur indépendance dans les années 1960, sans leur consentement. Or, ces dettes issues de la colonisation sont nulles en droit international public. Le Traité de Versailles de 1919 dispose dans son article 255 que la Pologne est exonérée de payer « la fraction de la dette dont la Commission des Réparations attribuera l’origine aux mesures prises par les gouvernements allemand et prussien pour la colonisation allemande de la Pologne ». Une disposition similaire fut prise dans le Traité de paix de 1947 entre l’Italie et la France, qui déclare « inconcevable que l’Éthiopie assure le fardeau des dettes contractées par l’Italie afin d’en assurer sa domination sur le territoire éthiopien ». L’article 16 de la Convention de Vienne de 1978 qui régit le droit des Traités ne dit pas autre chose : « Un État nouvellement indépendant n’est pas tenu de maintenir un traité en vigueur ni d’y devenir partie du seul fait qu’à la date de la succession d’États, le traité était en vigueur à l’égard du territoire auquel se rapporte la succession d’États » ;
la dette issue d’une colonisation. Au cours des années 1950 et 1960, la Banque mondiale a accordé plusieurs prêts aux métropoles coloniales dont la Belgique, la France, le Portugal et la Grande-Bretagne, pour des projets leur permettant de maximiser l’exploitation de leurs colonies. Ces dettes des puissances coloniales à l’égard de la Banque mondiale ont ensuite été transférées, pour la plupart, aux ex-pays colonisés au moment de leur indépendance dans les années 1960, sans leur consentement. Or, ces dettes issues de la colonisation sont nulles en droit international public. Le Traité de Versailles de 1919 dispose dans son article 255 que la Pologne est exonérée de payer « la fraction de la dette dont la Commission des Réparations attribuera l’origine aux mesures prises par les gouvernements allemand et prussien pour la colonisation allemande de la Pologne ». Une disposition similaire fut prise dans le Traité de paix de 1947 entre l’Italie et la France, qui déclare « inconcevable que l’Éthiopie assure le fardeau des dettes contractées par l’Italie afin d’en assurer sa domination sur le territoire éthiopien ». L’article 16 de la Convention de Vienne de 1978 qui régit le droit des Traités ne dit pas autre chose : « Un État nouvellement indépendant n’est pas tenu de maintenir un traité en vigueur ni d’y devenir partie du seul fait qu’à la date de la succession d’États, le traité était en vigueur à l’égard du territoire auquel se rapporte la succession d’États » ;
![]() les prêts octroyés aux dictatures. La nature dictatoriale d’un régime sous lequel la dette a été contractée permet de remettre en cause son paiement, même si le représentant de l’État qui a conclu le prêt avait la compétence pour le faire, en vertu du droit interne de l’État. En effet, en droit international, les dettes contractées sous des dictatures revêtent la qualification de « dette odieuse », selon la doctrine du même nom formulée par Alexander Sack en 1927 |49| : « Si un pouvoir despotique contracte une dette non pas pour les besoins et dans les intérêts de l’État, mais pour fortifier son régime despotique, pour réprimer la population qui le combat, etc., cette dette est odieuse pour la population de l’État entier […]. Cette dette n’est pas obligatoire pour la nation ; c’est une dette de régime, dette personnelle du pouvoir qui l’a contractée, par conséquent elle tombe avec la chute de ce pouvoir ». Alexander Sack ajoute que les créanciers de telles dettes, lorsqu’ils ont prêté en connaissance de cause, « ont commis un acte hostile à l’égard du peuple ; ils ne peuvent donc pas compter que la nation affranchie d’un pouvoir despotique assume les dettes ‘odieuses’, qui sont des dettes personnelles de ce pouvoir ». La doctrine de la dette odieuse permet donc de fonder la nullité de nombreux prêts comme ceux contractés par les dictatures en Amérique latine des années 1960 aux années 1980, en Afrique avec le cas emblématique du Zaïre de Mobutu (1965-1997), par les régimes de l’ancien bloc soviétique tels que la dictature de Nicolae Ceaucescu en Roumanie, les dictatures d’Asie du sud-est et d’Extrême-Orient (Ferdinand Marcos de 1972 à 1986 aux Philippines, Mohamed Suharto de 1965 à 1998 en Indonésie, des régimes dictatoriaux de Corée du Sud entre 1961 et 1981, de Thaïlande entre 1966 et 1988), la junte militaire en Grèce de 1967 à 1974, les dictatures en Afrique du Nord dont les régimes sont tombés au début 2011 comme celles de Zine el-Abidine Ben Ali en Tunisie (1987-2011) et Hosni Moubarak en Égypte (1981-2011). Commentant cette doctrine de la dette odieuse, les conseillers juridiques de la First National Bank of Chicago signalent que « les conséquences pour les accords de crédit d’un changement de souveraineté dépendent en partie de l’emploi des fonds par l’État prédécesseur. Si la dette du prédécesseur a été qualifiée d’‘odieuse’, c’est-à-dire, que les fonds ont été employés contre la population, la dette ne peut pas retomber sur le successeur » et ajoutent que « les banques commerciales doivent être sur leurs gardes face à cette doctrine [...] car des gouvernements successeurs ont invoqué des doctrines fondées sur l’utilisation ‘odieuse’ ou ‘hostile’ des fonds. Les prêteurs devraient décrire de façon détaillée l’emploi auquel on destinera les fonds prêtés et, dans la mesure du possible, engager le bénéficiaire par sa représentation, garantie et surveillance de l’usage de ces fonds |50| » ;
les prêts octroyés aux dictatures. La nature dictatoriale d’un régime sous lequel la dette a été contractée permet de remettre en cause son paiement, même si le représentant de l’État qui a conclu le prêt avait la compétence pour le faire, en vertu du droit interne de l’État. En effet, en droit international, les dettes contractées sous des dictatures revêtent la qualification de « dette odieuse », selon la doctrine du même nom formulée par Alexander Sack en 1927 |49| : « Si un pouvoir despotique contracte une dette non pas pour les besoins et dans les intérêts de l’État, mais pour fortifier son régime despotique, pour réprimer la population qui le combat, etc., cette dette est odieuse pour la population de l’État entier […]. Cette dette n’est pas obligatoire pour la nation ; c’est une dette de régime, dette personnelle du pouvoir qui l’a contractée, par conséquent elle tombe avec la chute de ce pouvoir ». Alexander Sack ajoute que les créanciers de telles dettes, lorsqu’ils ont prêté en connaissance de cause, « ont commis un acte hostile à l’égard du peuple ; ils ne peuvent donc pas compter que la nation affranchie d’un pouvoir despotique assume les dettes ‘odieuses’, qui sont des dettes personnelles de ce pouvoir ». La doctrine de la dette odieuse permet donc de fonder la nullité de nombreux prêts comme ceux contractés par les dictatures en Amérique latine des années 1960 aux années 1980, en Afrique avec le cas emblématique du Zaïre de Mobutu (1965-1997), par les régimes de l’ancien bloc soviétique tels que la dictature de Nicolae Ceaucescu en Roumanie, les dictatures d’Asie du sud-est et d’Extrême-Orient (Ferdinand Marcos de 1972 à 1986 aux Philippines, Mohamed Suharto de 1965 à 1998 en Indonésie, des régimes dictatoriaux de Corée du Sud entre 1961 et 1981, de Thaïlande entre 1966 et 1988), la junte militaire en Grèce de 1967 à 1974, les dictatures en Afrique du Nord dont les régimes sont tombés au début 2011 comme celles de Zine el-Abidine Ben Ali en Tunisie (1987-2011) et Hosni Moubarak en Égypte (1981-2011). Commentant cette doctrine de la dette odieuse, les conseillers juridiques de la First National Bank of Chicago signalent que « les conséquences pour les accords de crédit d’un changement de souveraineté dépendent en partie de l’emploi des fonds par l’État prédécesseur. Si la dette du prédécesseur a été qualifiée d’‘odieuse’, c’est-à-dire, que les fonds ont été employés contre la population, la dette ne peut pas retomber sur le successeur » et ajoutent que « les banques commerciales doivent être sur leurs gardes face à cette doctrine [...] car des gouvernements successeurs ont invoqué des doctrines fondées sur l’utilisation ‘odieuse’ ou ‘hostile’ des fonds. Les prêteurs devraient décrire de façon détaillée l’emploi auquel on destinera les fonds prêtés et, dans la mesure du possible, engager le bénéficiaire par sa représentation, garantie et surveillance de l’usage de ces fonds |50| » ;
![]() les prêts aux régimes dits « démocratiques » qui violent le jus cogens . Toutes les dettes contractées par des gouvernements violant les normes impératives du droit international contenues dans le jus cogens sont également nulles et non avenues, sans qu’il soit nécessaire de prouver que les créanciers avaient l’intention de se rendre complices des exactions de ces régimes. Cette affirmation trouve sa confirmation dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, qui, dans son article 53, prévoit la nullité d’actes contraires au jus cogens, regroupant entre autres les normes suivantes : l’interdiction de mener des guerres d’agression, l’interdiction de pratiquer la torture, l’interdiction de commettre des crimes contre l’humanité et le droit des peuples à l’autodétermination. Par conséquent, tout prêt octroyé à un régime, fût-il élu démocratiquement, qui ne respecte pas les principes fondamentaux du droit international, est nul. On peut citer, à titre d’exemples, le régime de l’Apartheid en Afrique du Sud ou le gouvernement israélien |51|. Dans ce cas, la destination des prêts n’est pas fondamentale pour la caractérisation de la dette ;
les prêts aux régimes dits « démocratiques » qui violent le jus cogens . Toutes les dettes contractées par des gouvernements violant les normes impératives du droit international contenues dans le jus cogens sont également nulles et non avenues, sans qu’il soit nécessaire de prouver que les créanciers avaient l’intention de se rendre complices des exactions de ces régimes. Cette affirmation trouve sa confirmation dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, qui, dans son article 53, prévoit la nullité d’actes contraires au jus cogens, regroupant entre autres les normes suivantes : l’interdiction de mener des guerres d’agression, l’interdiction de pratiquer la torture, l’interdiction de commettre des crimes contre l’humanité et le droit des peuples à l’autodétermination. Par conséquent, tout prêt octroyé à un régime, fût-il élu démocratiquement, qui ne respecte pas les principes fondamentaux du droit international, est nul. On peut citer, à titre d’exemples, le régime de l’Apartheid en Afrique du Sud ou le gouvernement israélien |51|. Dans ce cas, la destination des prêts n’est pas fondamentale pour la caractérisation de la dette ;
![]() les prêts détournés avec la complicité des créanciers. La doctrine de la dette odieuse range également dans cette catégorie « les emprunts contractés dans des vues manifestement intéressées et personnelles des membres du gouvernement ou des personnes et groupements liés au gouvernement — des vues qui n’ont aucun rapport aux intérêts de l’État ». En effet, « les dettes d’État doivent être contractées et les fonds qui en proviennent utilisés pour les besoins et dans les intérêts de l’État ». Pour illustrer cet élément de la doctrine, on peut notamment citer la sentence arbitrale rendue en 1923 dans une affaire opposant la Grande-Bretagne au Costa Rica. En 1922, le Costa Rica promulgua une loi qui annulait tous les contrats passés entre 1917 et 1919 par l’ancien dictateur Federico Tinoco et refusa donc d’honorer la dette qu’il avait contractée auprès de la Royal Bank of Canada. Il s’agit donc d’un cas où la doctrine a été appliquée pour une dette commerciale. Le litige qui s’ensuivit entre la Grande-Bretagne et le Costa Rica fut arbitré par le président de la Cour Suprême des États-Unis, le juge William Howard Taft, qui déclara valide la décision du gouvernement costaricain en soulignant : « le cas de la Banque royale ne dépend pas simplement de la forme de la transaction, mais de la bonne foi de la banque lors du prêt pour l’usage réel du gouvernement costaricain sous le régime de Tinoco. La Banque doit prouver que l’argent fut prêté au gouvernement pour des usages légitimes. Elle ne l’a pas fait. » Plus récemment, la CAIC en Équateur a mis en évidence le fait que certains prêts ont été déviés de leur objectif de « développement ». En effet, trois crédits de la Banque intéraméricaine de développement (BID) censés profiter aux secteurs agricole, financier et des transports ont partiellement servi à acheter des bons Brady.
les prêts détournés avec la complicité des créanciers. La doctrine de la dette odieuse range également dans cette catégorie « les emprunts contractés dans des vues manifestement intéressées et personnelles des membres du gouvernement ou des personnes et groupements liés au gouvernement — des vues qui n’ont aucun rapport aux intérêts de l’État ». En effet, « les dettes d’État doivent être contractées et les fonds qui en proviennent utilisés pour les besoins et dans les intérêts de l’État ». Pour illustrer cet élément de la doctrine, on peut notamment citer la sentence arbitrale rendue en 1923 dans une affaire opposant la Grande-Bretagne au Costa Rica. En 1922, le Costa Rica promulgua une loi qui annulait tous les contrats passés entre 1917 et 1919 par l’ancien dictateur Federico Tinoco et refusa donc d’honorer la dette qu’il avait contractée auprès de la Royal Bank of Canada. Il s’agit donc d’un cas où la doctrine a été appliquée pour une dette commerciale. Le litige qui s’ensuivit entre la Grande-Bretagne et le Costa Rica fut arbitré par le président de la Cour Suprême des États-Unis, le juge William Howard Taft, qui déclara valide la décision du gouvernement costaricain en soulignant : « le cas de la Banque royale ne dépend pas simplement de la forme de la transaction, mais de la bonne foi de la banque lors du prêt pour l’usage réel du gouvernement costaricain sous le régime de Tinoco. La Banque doit prouver que l’argent fut prêté au gouvernement pour des usages légitimes. Elle ne l’a pas fait. » Plus récemment, la CAIC en Équateur a mis en évidence le fait que certains prêts ont été déviés de leur objectif de « développement ». En effet, trois crédits de la Banque intéraméricaine de développement (BID) censés profiter aux secteurs agricole, financier et des transports ont partiellement servi à acheter des bons Brady.
Pour des actes unilatéraux contre la dette
Il n’existe pas, en droit international, d’obligation absolue de rembourser les dettes. En revanche, le droit international impose aux pouvoirs publics de protéger en priorité les droits humains. Compte tenu du poids de la dette publique et de l’impact des mesures d’austérité sur les populations au Nord et au Sud, les gouvernements doivent user de leur droit de suspendre unilatéralement le remboursement des dettes publiques, à l’instar de l’Argentine (en 2001) et de l’Équateur (en 2008) qui l’ont fait de manière partielle. Pendant cette période de suspension de paiement de la dette (avec gel des intérêts), ces gouvernements ont intérêt à mener des audits de leurs dettes publiques (externes et internes) afin d’identifier les irrégularités entachant certains contrats de prêts. Ils peuvent ensuite invoquer les règles du droit international public (mais pas seulement) pour déclarer unilatéralement la nullité des dettes illicites, comme l’a fait récemment le Paraguay en 2005. Cet exemple n’est pas un cas isolé. Plusieurs gouvernements, dans l’Histoire, ont refusé de payer une dette héritée du régime qui les précédait, arguant que cette dette n’engageait que le régime en question, non l’État |52|.
Ces actes unilatéraux ne sont pas contraires au droit international puisque la décision souveraine d’annuler / répudier une dette rentre dans la catégorie des actes unilatéraux, qui sont des sources du droit international et sont opposables aux créanciers |53|. Le CADTM est bien évidemment pour des actes unilatéraux qui vont dans le sens de la protection des droits humains.
Dans ce contexte, la mise en place d’un arbitrage international sur la dette n’est pas souhaitable. En effet, ce mécanisme ne peut être juste et efficace que si les droits humains prédominent sur le droit des créanciers et si les peuples ne sont pas confinés dans le rôle de simple « témoin ». Or, le rapport de force politique actuel en faveur des créanciers risque fortement d’être au détriment des peuples du Sud et du Nord. Dans un processus d’arbitrage, les règles sur lesquelles se fonderaient les arbitres pour rendre leur sentence sont le résultat des négociations entre créanciers et débiteurs. Dans ce contexte, les notions juridiques que nous avons mises en avant ne seront très certainement pas acceptées par la majorité des créanciers. On se souvient notamment de l’hostilité de la Banque mondiale à la doctrine de la dette odieuse, dans son rapport de septembre 2007 intitulé « Odious Debt : some considerations » |54|. Il en va de même pour d’autres arguments juridiques tels que l’enrichissement sans cause, le dol, l’abus de droit, l’équité, la bonne foi...
Au-delà de la controverse sur les notions de « dette odieuse » et de « dette illégitime », il faut noter l’hostilité quasi générale des créanciers à faire le lien entre la dette et les droits humains. Nous reprenons ici l’extrait d’une interview de l’actuel expert indépendant de l’ONU sur la dette publique externe, réalisée en 2009 : « les États du Nord considèrent que la problématique de la dette n’a aucun lien avec les droits humains, qu’elle est purement économique et qu’elle doit donc être traitée en dehors du Conseil des droits de l’homme et de l’Assemblée générale de l’ONU (...) Les responsables de la Banque mondiale que j’ai consultés ont des positions différentes entre eux. Certains réfutent catégoriquement l’approche basée sur les droits humains pour ne considérer que la dimension économique de la dette |55| ».
Par conséquent, si un mécanisme d’arbitrage venait à être mis en place, les peuples seraient très certainement les grands perdants. Car les sentences arbitrales risquent, d’une part, de légitimer des dettes qualifiées d’« odieuses » et d’« illégitimes » par les mouvements sociaux ou par le gouvernement qui les mettraient en avant (via un audit). Le gouvernement du pays endetté devrait alors respecter la sentence et donc rembourser ces dettes, au détriment des besoins fondamentaux de sa population. D’autre part, ces sentences formeraient une jurisprudence internationale qui servirait de source d’inspiration pour trancher les futurs litiges. Les règles ainsi appliquées (au bénéfice des créanciers en raison de l’actuel rapport de force politique) ne favoriseraient alors pas des politiques de prêts « responsables ».
Pour toutes ces raisons, les gouvernements ont donc intérêt à prendre immédiatement des actes unilatéraux sur la dette. A l’instar des juristes présents à la 1ère Rencontre internationale de juristes tenue à Quito en 2008 : « Nous soutenons les actes souverains des États qui, fondés en droit, déclarent la nullité d’instruments illicites et illégitimes de la dette publique, et avec elle la suspension des paiements |56| ». Peu importe la qualification employée (« dette illicite » ou « dette illégitime »), nous exhortons les gouvernements emprunteurs mais aussi créanciers à répudier/annuler toutes les dettes et les politiques de rigueur qui vont à l’encontre des intérêts des peuples.
C’est pourquoi le CADTM encourage également les initiatives législatives et les référendums qui vont à l’encontre des lois, des règlements ou des accords contraires à la souveraineté populaire ou au respect des droits fondamentaux, qu’ils soient déjà en vigueur ou en cours de négociation. La consultation populaire sur le non-remboursement d’une dette, à l’instar du référendum organisé en Islande sur la loi dite « Icesave », fait partie de ces mécanismes qu’il faut promouvoir et dont les résultats doivent être pris en compte par les autorités publiques |57|.


